Sommaire
À l’ère irrationnelle de la post-démocratie où les pouvoirs politiques soumis aux diktats économiques n’ont que faire des apports scientifiques, penser par soi-même n’est pas simplement une exigence éthique, cela devient une question vitale. Cette autodéfense intellectuelle populaire rejoint les foyers d’une intelligence sociale en résistance. Elle nous amène autrement à traduire en termes de tiers espaces réflexifs autonomes un monde du vivant qui échappe à l’exploitation productiviste extractiviste.
J’ai reçu la question suivante à propos de la recherche-action qui a été l’origine de l’écriture de ce texte : « Si nous sommes tous chercheurs/enquêteurs, à quoi sert le chercheur professionnel/académique ? ».
Cette question ne concerne pas une simple défense corporatiste qui se voit contester son autorité d’expert-sachant. Ce n’est pas non plus seulement un débat épistémologique entre production de savoir expérientiel et institutionnel, profane et savant. Nous ne pouvons pas faire abstraction du contexte actuel, sociopolitique et géopolitique, celui de la remise en cause systématique du savoir scientifique.
La recherche-action en instaurant un croisement horizontal des savoirs ne contribue-t-elle pas à un relativisme du savoir académique aujourd’hui attaqué de toute part ? N’est-ce pas dans cet aplanissement où toute argumentation se vaut que se complait le complotisme ; dans cette aspiration orwellienne à la « post-vérité » que couve la montée du fascisme ?
Nous pourrions inverser la proposition et soutenir que c’est parce que nous entrons dans une ère post-démocratique que se répand l’attaque systématique de tous les savoirs. En cela, la recherche-action est au contraire la mieux armée pour contrecarrer une spoliation de l’espace public en ouvrant de nouveaux espaces autonomes d’échanges et d’argumentation, puis en vérifiant les conditions réelles d’une transformation sociale dans un aller-retour réflexif.
Ce n’est pas alors en préservant la hiérarchisation des savoirs que peut être réhabilité l’autorité de la recherche, mais en plongeant au cœur des situations humaines pour en refonder les conditions démocratiques. Cela commence par promouvoir une recherche du dehors à l’image des « classes du dehors ». Hors des lieux d’emprise, relier sciences sociales et sciences du vivant pour déconstruire méthodiquement derrière la façade, l’hégémonie d’un capitalisme débridé et ses conséquences impérialistes. Concevoir une recherche stratégique, négocier des espaces d’intermédiation légitimant la posture d’acteur-chercheur et le principe de laboratoire social.
Professionnalité et recherche-action
C’est une question qui pourrait finalement concerner beaucoup de secteurs d’activité. J’exerçais précédemment dans le champ social. Je me rappelle que l’on posait ce constat qu’un bon travailleur social devait viser à la disparition de sa profession puisque son but était que les personnes s’émancipent d’une relation d’aide.
De même, dans le champ culturel, les professionnels de la profession ne devraient-ils pas sortir des lieux d’une notabilité cultuelle et viser la reconnaissance des droits culturels, promouvoir une démocratie culturelle développant les potentialités créatives de chacun ?
Il n’en est pas autrement pour le champ de la recherche en sciences humaines et sociales, où les professionnels ne devraient pas s’enfermer dans les lieux d’une notabilité intellectuelle, mais plutôt viser à l’appropriation par tous des outils d’une analyse critique favorisant une production autonome de savoir.
De plus, on peut concevoir la recherche-action dans cette optique comme un processus instituant qui par définition crée ses propres normes d’évaluation et de validation in situ. Ce que nous appelons des « tiers espaces réflexifs ».
L’ouverture comme nous avons pu le vivre d’un espace dans les locaux des bas d’immeubles de quartiers populaires, au milieu d’un marché de récupérateurs vendeurs de rue, dans une ZAD, une friche industrielle ou un champ agricole, constituent autant de lieux d’accueil inconditionnel, de croisement d’expérience, de bifurcation de parcours de vie, de formation réciproque, d’autorisation à expérimenter et à faire de ces acquis un savoir partagé et diffusable.
Le propre des tiers espaces est de proposer une autre cohérence existentielle et intellectuelle non à partir du lieu ou d’une intervention (imposition de normes instituées), mais du milieu et d’une intermédiation (jeux situationnels d’interaction et d’interrelations), où chaque personne, indépendamment de son appartenance socioprofessionnelle, peut prendre une liberté de mouvement justement parce que la posture « d’acteur(trice)-chercheur(e) » n’est ni une profession ni un statut.
Cette posture interroge la position d’Agent (mission dans une structure) et ouvre plus d’amplitude à celle d’Acteur (maîtrise d’un changement) et d’Auteur (mise en place de nouveaux référentiels). Ce « pas de côté » ne s’oppose pas à une professionnalité, mais bien au contraire contribue à son enrichissement.
Cette créativité s’exprime par la possibilité de se réapproprier un vocabulaire détourné par un capitalisme cognitif et une économie de l’attention, de construire une grammaire culturelle s’ouvrant sur un autre imaginaire, une société désirable guidée par des passeurs de frontières et par l’identité relation d’un « Tout-Monde ».
Processus horizontal et coopératif en correspondance avec le vivant
Oui, mais voilà, les champs professionnels appartiennent à des logiques sectorielles très verticales, comme autant d’œillères focalisant les énergies sur les luttes internes pour l’orientation de ces champs. La recherche-action ne peut pas faire l’impasse d’une analyse critique de ces enjeux de pouvoirs.
Mais qui est prêt à faire ce changement de perspective en matière de pensée et d’action ? Nous sommes loin de l’après 68, à l’exemple de l’université ouverte de Vincennes quand l’institution s’interrogeait sur ses propres enfermements, notamment à travers le courant de l’analyse institutionnelle et le principe d’université populaire.
Il ne s’agit pas d’être nostalgique d’une époque, mais d’être attentif aux endroits de production de savoirs ouverts et alternatifs. Ils n’ont jamais cessé d’exister, ils se sont même démultipliés. Encore faut-il vouloir les dénicher en dehors des lieux classiques, comme autant de foyers contre-culturels qui mettent la société en recherche sur elle-même.
La recherche-action qui n’est pas une simple méthodologie d’intervention s’avère particulièrement adaptée pour prendre en compte ces espaces dans toute la diversité systémique propre au vivant, car c’est une science « indisciplinée ».
Échapper à l’imposition de normes extérieures (ordre hétéronome de la validation disciplinaire) ne signifie pas un manque de rigueur. Simplement, elle ne se protège pas derrière un savoir technicien. Au contraire, elle désacralise les méthodologies de recherche, évitant la fétichisation de l’outil comme une fin en soi, symbole du pouvoir de l’intervenant expert. Produire un savoir n’est pas le propre d’un secteur professionnel qui en détiendrait le monopole.
En permettant à chacun de s’approprier ces outils, elle interroge également les circuits formatifs et les modalités diplômantes. Plutôt que s’établir sur la mise en rivalité de parcours selon l’excellence individuelle, elle prône la coopération et la validation collective des acquis d’expérience. C’est dans une articulation entre science de la complexité et de la reliance que s’exprime une intelligence sociale et se conçoivent des réponses aux problématiques de société.
S’établit ici une correspondance avec le monde du vivant oubliée par notre humanité, dans le sens où il ne peut avoir d’enrichissement mutuel et de renforcement des solidarités sans accueil inconditionnel d’une diversité dans une interdépendance des relations.
Pas de justice cognitive sans justice sociale
De même, il ne peut avoir de justice cognitive (accès et reconnaissance des savoirs) sans justice sociale (lutte contre les formes de discrimination, d’exclusions, de domination). Le savoir professionnel renouant avec le projet originel des sciences sociales devrait se mettre au service de cette justice sociale et cognitive telle que le formule une épistémologie du Sud et qu’un Nord ethnocentré et hégémonique a occulté.
Ainsi, l’entre-deux des tiers espaces réflexifs permet de penser le « tiers » comme dépassement de la logique binaire (profane/savant, amateur/professionnel, intérieur/extérieur, privé/public, sensible/intelligible). Ce décentrement pourrait contribuer à l’instauration de nouvelles centralités, espaces-temps libérés du travail assujetti, réfractaires aux dominations/discriminations de classe, de genre, de race. Ce que furent les Maisons du Peuple comme lieux de ressources, de protection et de croisements entre savoirs expérientiels et professionnels, empiriques et institutionnels.
La condition autonome de ces espaces crée les conditions d’une extériorité dans l’ordre institué. C’est une recherche à l’intérieur du dehors et au dehors de l’intérieur. De cette manière, le travail réflexif interroge les conditions de production de savoir. Du reste, le monde académique peut de moins en moins se prévaloir d’une indépendance qui faisait sa qualité par rapport aux pressions économiques et politiques.
En témoignent les usines à réponse aux appels à projets dont les principes court-termistes et productivistes rejoignent la brutalisation idéologique d’un darwinisme social. Le fondement coopératif est remplacé par celui de concurrence au non d’une sacro-sainte compétitivité. Les contraintes d’efficacité et de rentabilité sont entrées dans l’organisation d’un « new public management », cheval de Troie du néolibéralisme.
Des tiers espaces réflexifs autonomes
Ainsi, les recherches dites « participatives » sous la caution de l’énoncé « recherche-action » sont devenues un marché comme un autre.
À l’heure où le capitalisme sans garde-fous étatique n’a plus que faire d’une démocratie qu’il a soigneusement évidée, les sciences sociales ne sont plus qu’un paravent lorsqu’elles sont convoquées pour combler le déficit démocratique.
Cette injonction à la participation est d’autant plus paradoxale que les pouvoirs commanditaires n’ont de cesse d’affaiblir les corps intermédiaires, les mécanismes de ce qui fut appelé « État social » et les contre-pouvoirs indispensables à une démocratie.
Un véritable travail réflexif sur l’implication du chercheur dénoncerait une nova langue qui dévitalise le processus d’engagement et fait de la participation au mieux un gadget, au pire un dispositif anti-démocratique.
Il serait plus judicieux de s’intéresser à la non-participation comme modalité active de résistance et comprendre comment l’apparition d’espaces de déprise peut traduire une redistribution de la donne politique comme lieux hétérotopiques de nouvelles centralités populaires.
Le parallèle avec le monde du vivant est une nouvelle fois pertinent, quand les « tiers paysages », échappant à l’emprise productiviste extractiviste agricole, deviennent les meilleurs garants d’une biodiversité. Comprenons que les « tiers espaces » autonomes, réflexifs, comme traduction sociale et cognitive des tiers paysages, échappent à l’emprise productiviste extractiviste des savoirs.
La recherche-action interroge justement les conditions d’exercice de production de savoir, ce que devraient faire tous les chercheurs comme tous les acteurs. Il n’existe dans ce sens qu’une seule réflexivité, celle qui crée les conditions de son autonomie. D’ailleurs, même ceux issus de l’école bourdieusienne reviennent sur l’opposition entre réflexivité du quotidien et académique.
Au même titre que l’ethnométhodologie fut appelée une « sociologie radicale », nous pourrions convenir que la recherche-action est une « science sociale radicale du vivant » à condition d’arrêter de lui faire un procès en scientificité. Il est plus utile d’instaurer des tiers espaces réflexifs en partage. Comment se négocient concrètement ces espaces autonomes ? Comment concevoir ces îlots en chapelets comme des archipels reliant le singulier à l’universel, le local au global ? Quelles stratégies socioprofessionnelles adaptées, selon quelles modalités économiques ? Cela nécessite inévitablement une contre-analyse qui s’appuie sur la négociation de ces espaces autonomes d’intermédiation et la légitimation de la position d’acteur(trice)-chercheur(se).
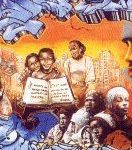



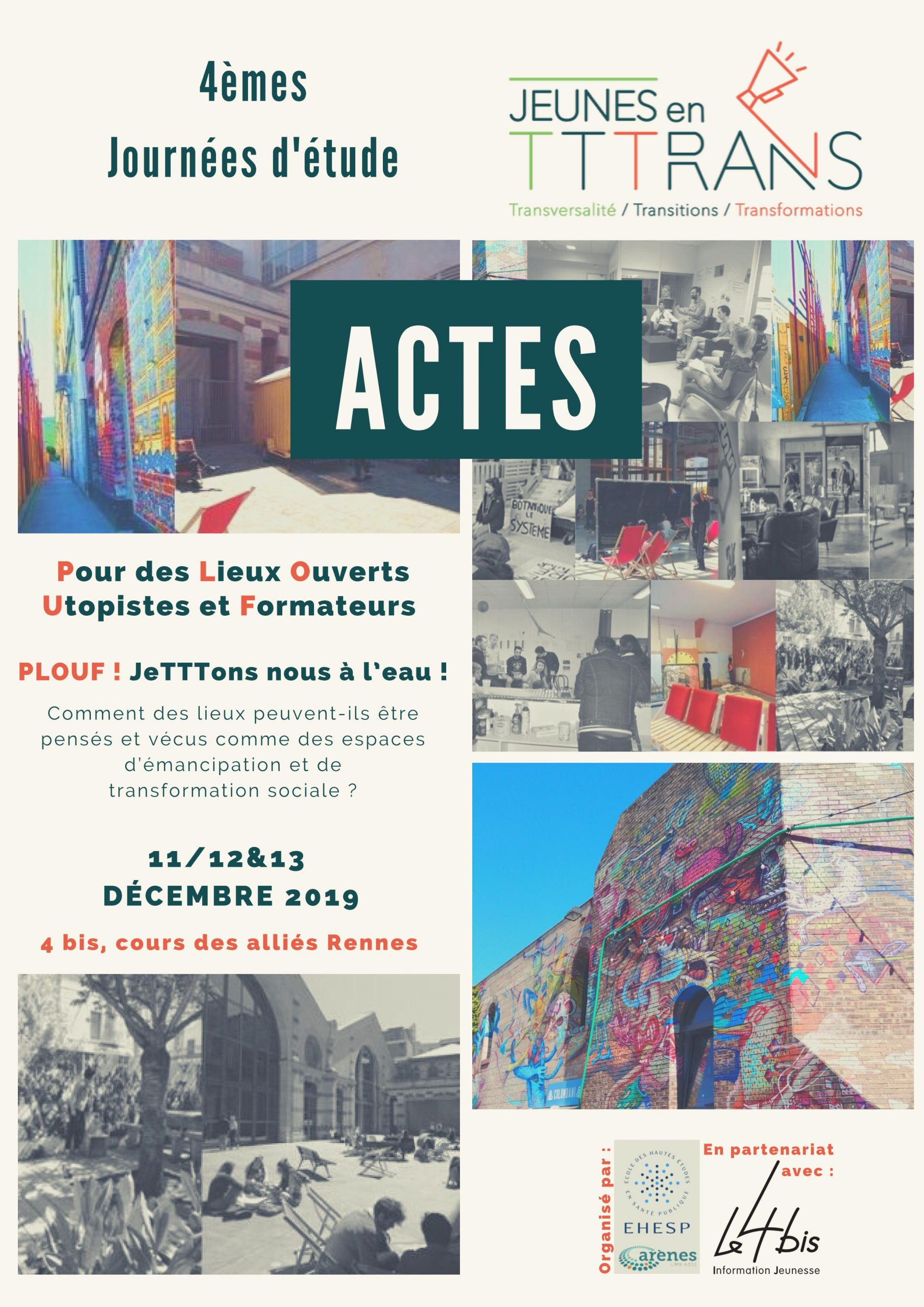


Merci pour ce texte dans lequel je me retrouve tellement ! Étant plutôt une non-chercheuse indisciplinée et indisciplinable et une actrice de la connexion entre monde académique et citoyenneté, ma légitimité se construit dans les.marges des sciences sociales…..
Comment trouver une place dans ce monde polarisé !??
La recherche action, la recherche participative et ses actrices et acteurs semblent être le terreau fertile de l’émergence de savoirs engagés et reliés !!
Encore merci pour ce texte qui offre une sourdine à l’imposteur-ice qui parle trop souvent quand je me projette chercheuse !!