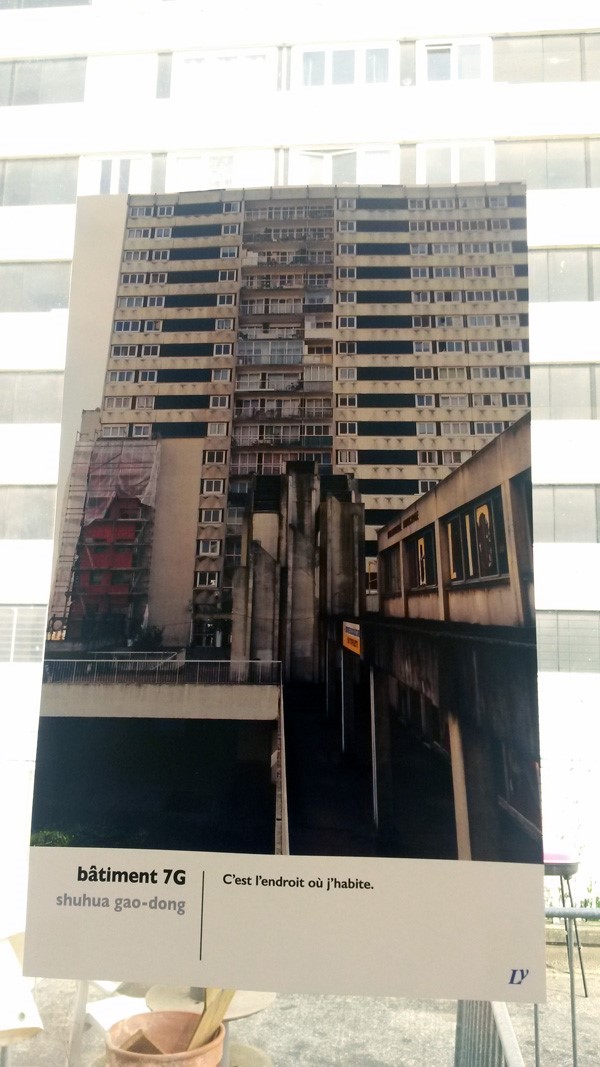Entre marchandisation et sécurisation de l’espace
Le mobilier urbain anti-pauvre (et anti-jeune) se multiplie comme l’esthétique lisse et saillante d’une violence ordonnée appelée « design défensif ». Cela fait plus d’une dizaine d’années que les premiers dispositifs sont apparus en France.
La récente polémique initiée par la mairie d’Angoulême de privatiser des bancs publics en les entourant de grillages n’est que la partie émergée d’un mouvement de fond qui touche à la gestion de l’espace public comme révélateur des rapports sociaux d’une société.
Les excroissances urbaines de ce mobilier[1] ne s’adressent pas seulement aux clochards bruyants, aux punks à chiens itinérants, mais à tous ceux qui dorment, stationnent, se rassemblent, glissent, jouent et se jouent de ce mobilier et qui n’ont pas d’autres choses de plus intéressantes et futiles à faire que de parler, se rencontrer, se raconter, s’amuser, bref de jouir et produire une socialité urbaine au pouvoir fortement diversifiant et intégrateur, mais difficilement récupérable dans le circuit marchand.
Si les commerçants du centre-ville d’Angoulême ne veulent plus de ces gueux et ont alerté la municipalité, ce n’est pas pour rendre la rue plus vivable, mais la rendre plus propre à la consommation. En cela, il n’y a pas de différence notable, entre l’esthétique urbaine lisse et l’esthétique télévisuelle lisse qui veut rendre un peu plus de cerveaux disponibles propres à consommer la publicité comme le confiait de manière si désarmante un responsable de chaîne. Finalement, c’est toute l’existence humaine et plus simplement sa force de travail qui n’est acceptée et acceptable que marchandisée et marchandisable[2].
Pour pousser à accepter ce glissement depuis quelques décennies, nos différents gouvernements aimeraient faire croire que seule l’économie nous gouverne. La duperie vient de la prétention à nous donner du travail alors que l’intérêt industriel réside dans ce que l’on fait quand on ne travaille pas. Pour vendre des émotions par procuration, les espaces de vie sont devenus des enjeux économiques essentiels à condition d’en déloger la conscience politique, c’est-à-dire fermer l’espace public. Mais c’est finalement fermer toute la société à la vie, elle s’autodigère dans une économie anthropophage comme un immense reality show.
L’architecture hostile « anti-stationnement » non seulement déchiquette cette part d’humanité indésirable, celle qui ne se laisse pas consommer et ne consomme pas, mais dans une faim insatiable agit comme un trou noir absorbant toute matière humaine au passage sans distinction de ressources et de couleur. C’est une forme antipatrimoniale qui aspire de l’intérieur pour vider de sa substance ce qui fonde la ville, ce patrimoine commun des luttes, des croisements, de la diversité et de l’hospitalité.
Des précurseurs comme les graffeurs[3] adeptes du « graffiti vandale » avaient déjà en leur temps décrié ce rapport marchand à l’espace en soutenant que la répression de leur expression au nom du jugement esthétique ne servait que l’esthétique lisse des panneaux publicitaires et du marketing officiel. La différence, c’est que l’on ne paie pas pour voir leurs fresques. Un acte libre et gratuit où « les murs appartiennent à ceux qui les regardent » ne peut qu’interroger par sa simple existence les conditions politiques d’émergence d’un espace public, cela bien avant que la mode du « Street Art » vienne lisser cette esthétique en rébellion recyclable. Même les policiers new-yorkais de l’époque pourtant prescripteurs du dogme de la « tolérance zéro » (qui connut depuis un vif succès mondial) reconnaissaient l’absence de lien entre graffiti et criminalité. A contrario, l’initiative récente de la ville de Grenoble de ne pas renouveler le contrat d’affichage publicitaire pour libérer de l’espace public, si elle est une exception qui confirme la règle, pourrait devenir un laboratoire social très intéressant.
Cette alliance objective pour ne pas dire connivence entre sécurisation de l’espace et marchandisation de l’espace connaît un nouveau développement sous l’ère numérique avec l’emploi systématique de l’« Analyse des formes de vie » (pattern of life analysis). Qu’il s’agisse de surveiller la population ou de lui vendre quelque chose, le principe reste le même : collecter des données multiples pour dresser des profils identifiables. Des clics Facebook aux caméras de surveillance, ce qui est important ce n’est plus vous en tant que personne, mais votre profil. Il s’agit de cerner une « signature » par vos habitudes, vos trajets, vos conversations, vos liens.
Ces méthodes de schématisation gomment les aspérités et les singularités individuelles pour dresser des catégories qui deviennent des « publics cibles » au profit d’usages commerciaux ou sécuritaires. Les drones antiterroristes[4] et les programmes fureteurs sur Internet obéissent aux mêmes algorithmes. Pour tuer ou faire consommer, il faut déterminer l’intention avant que l’acte soit commis en comparant votre comportement à un schéma type. Votre pattern virtuel vous colle à la peau de manière bien réelle et à la différence de l’avatar de « Second Life », vous ne pouvez pas tourner le bouton pour arrêter la machine. Cette déshumanisation par dissociation enlève tout libre arbitre aussi bien pour la victime que pour le bourreau. Ce « système technicien »[5] précède les nouvelles technologies qui sont venues le renforcer. Il s’auto-alimente comme une force de production autonome, une entité spécifique découplée moralement de l’homme et fonctionnant d’autant mieux que l’homme reste ignorant de sa condition. Remarquons que le chiffre « zéro » s’emploie fréquemment pour qualifier des directives ou des dispositifs sécuritaires : « zéro risque », « tolérance zéro ». C’est le propre du langage binaire informatique. Le système technicien n’est pas contre l’homme ou pour l’homme, il est autre, il est « zéro » ou « un ».
Cette « police des schémas » s’applique aux pauvres pour les constituer en catégorie éjectable de l’espace public. Il s’agit de criminaliser leur présence comme un facteur anxiogène ou pathogène à éradiquer. Cette rhétorique du « territoire à reconquérir » s’emploie aussi pour les banlieues afin de justifier la militarisation de la police[6]. La construction sociale (naturalisation) d’une population discriminée par ethnicisation de l’espace fabrique un groupe à part pour lequel il devient « naturel » qu’il ne possède pas tout à fait les mêmes droits que la communauté des citoyens[7]. Pour être acceptable, le recours systématique à la force doit apparaître comme la violence légitime de l’autorité publique.
C’est le même procédé de racialisation sur lequel se sont appuyées les dominations coloniales ou esclavagistes. Pour les priver de toute liberté et faire fonctionner les transactions économiques, il était important que l’esclave devienne un mobilier. Loin des fers de fond de cale, de manière plus subtile et cachée, le « design pattern » du mobilier urbain défensif correspond au « social pattern » du pauvre transformer en mobilier que l’on peut ensuite impunément chasser en masse. Cela se traduit en système technicien par : « concevoir un modèle répondant à un problème récurrent ».
« La gestion technocratique considère les corps comme des objets qui gênent la régulation des flux. Les citoyens sont infantilisés, agressés pas ces dispositifs anti-ergonomiques. L’espace est dégradant/dégradé. Aujourd’hui, l’espace public cesse d’être un espace partagé. Ils incarnent les violences du pouvoir » (Le « Repos du fakir » esquisse une typologie du mobilier urbain parisien, livret complémentaire) :
Les vendeurs de rue appelés « biffins »[8], descendant des chiffonniers, dont on pourrait reconnaître pourtant l’utilité économique en tant que récupérateurs vendeurs de nos objets délaissés sont chassés de nos rues et de nos squares. La comparaison avec les scènes de chasse est d’autant plus frappante que les forces de police sont parfois équipées de vélos, motos, chevaux, renforçant du haut de leur monture l’instinct du prédateur face au gibier.
La chasse à l’homme est un rituel qui ne date pas d’hier[9], mais il ne s’agit pas comme au XVIIe siècle sous le couvert de l’idéologie hygiéniste de récupérer les pauvres dans la rue pour les enfermer à l’Hôpital Général afin de les mettre de force au travail. Aujourd’hui, la peur des classes dangereuses se traduit par des mesures d’éloignement dans des territoires non définis, loin très loin, un nulle part au-delà de la ligne d’horizon du pensable afin que nous ne puissions pas dénoncer les conditions de vie infra-humaines de cette relégation.
Tout processus d’oppression génère sa culture de résistance. Les luttes sociales se réinventent à l’aune du changement radical des rapports de production. Un système à prétention totalitaire possède ses propres failles. La rue, par le fait même qu’elle est à la fois le début et la fin d’un processus de marchandisation, provoque des tensions. Par exemple, entre des émergences insoumises et leur récupération en tendances mainstream se logent des pratiques urbaines créatrices comme nous l’avons remarqué à propos du graffiti ou du parkour[10].
Des pratiques d’« urbain hacking » appliquent comme son nom l’indique la culture hacker du détournement-réappropriation aux éléments de l’espace urbain comme voie possible d’une auto-fabrication de la ville. Ainsi, au design « défensif » technicien s’oppose un design « Do-It-Yourself » spontané et brut selon les méthodes créatives de récupération et recyclage des matériaux disponibles en formes nouvelles (« upcycling »). Quelques installations « hacktivistes » :
Oliver Schau Florian Riviere RainCity Housing
C’est une manière de réaffirmer le caractère non-propriétaire de l’espace public comme espace du commun partageable. Cette approche interventionniste et expérimentale au-delà de son caractère éphémère et bricolé, si elle est portée par ceux qui vivent « dans » la rue ou « de » la rue peut se traduire en processus d’innovation sociale apportant des réponses concrètes et peu onéreuses, du logement des sans-abris à l’étal des récupérateurs-vendeurs. Des expérimentations de « Guerrilla Housing » :
Karl Philips Atelier Van Lieshout
Design d’abri pour les sans-abri :
Ces mouvements de type « Guerrilla Housing » qui exploitent les interstices urbains et juridiques pour instaurer un habitat non-conformiste participent à l’ouverture de contre-espaces, qui ne sont pas « contre », mais « tout-contre »[11]. Certains forment de véritables écosystèmes humains pour constituer des archipels comme le réseau des tiers-lieux ou des ZAD. Ces espaces autonomes sont propices à un nouvel imaginaire instituant[12] une « architecture fluide » qui replace l’humain au centre[13] et une « rue marchande »[14] qui se base sur une maîtrise d’usage de l’espace public.
Hugues Bazin
[1] Des sites recensent cette « nouvelle architecture », piques sur le sol, bancs inclinés, fausses plantes décoratives pour empêcher de s’asseoir ou se coucher… : http://contrelavillehostile.wesign.it/fr – http://urbanisme-inhumain.tumblr.com/ – http://www.survivalgroup.org/anti-site.html – http://unpleasant.pravi.me/category/strategies/reapropriation/
[2] Bernard Floris, Marin Ledun, La vie marchandise : Du berceau à la retraite, le marketing veille sur vous, La Tengo, 2013.
[3] Hugues Bazin, « L’art d’intervenir dans l’espace public », document électronique, 2005.
[4] Grégoire Chamayou, Théorie du drone, La Fabrique Editions, 2013
[5] Jacques ELLUL, Le Système technicien, Calmann-Lévy, 1977. – Le bluff technologique, Hachette, 1988 (coll. La force des idées).
[6] Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Éditions du Seuil, 2011. Benoît Dupont, Frédéric Lemieux, La militarisation des appareils policiers, Presses Universitaires de Laval, 2005. Hacène Belmessous, Opération Banlieues. Comment l’État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises, La Découverte, 2010 (Col : Cahiers Libres).
[7] Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Agone, 2004.
[8] Hugues Bazin, « Les pêcheurs de lune », document électronique, 2013. Hugues Bazin, Stéphane Rullac, « Les biffins et leurs espaces marchands : seconde vie des objets et des hommes », Informations sociales no182, Paris : CNAF, 2014, pp.68-74
[9] Grégoire Chamayou, Les Chasses à l’homme, La Fabrique éditions, 2010.
[10] Hugues Bazin, « Les arpenteurs ouvreurs d’espaces », revue Arpentages, 2013.
[11] Hugues Bazin, « Les figures du tiers espace : contre-espace, tiers paysage, tiers lieu », document électronique, 2013.
[12] Cornelius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, 1975, Seuil.
[13] Hugues Bazin, « La marchabilité du citoyen arpenteur acteur chercheur, écologie des mobilités et architecture fluide », document électronique, 2014 (A paraître dans la revue Arpentages)
[14] http://recherche-action.fr/ruemarchande/
-
Crédit vidéo : Fabian Brunsing, Pay & Sit – the Private Bench, 1″27, 2008, – Arte Journal, Paris : le mobilier anti-SDF, 2″26, 2010 – Gilles Paté, Stéphane Argillet, Le repos du fakir, 6″20, Canal Marches 2003
- Crédit photos N&B : Paps Touré, Homeless, 2009 – photos mobilier anti-site : Urbanisme inhumain – Survival group – photos Biffins, ZAD : Hugues Bazin