Des mesures techniques d’isolation aux stratégies politiques du contact : plaidoyer pour une auto-graphie sociale.

Photo : Adrien Delpeuch (Prise au Gymnase Lovy à Tulle, le 9 août 2014, à l’occasion de l’atelier « Contact » #1, organisé par les collectifs Coping et Medication Time)
Nous sommes un certain nombre de personnes, issues de milieux et d’univers différents, avec des vies, des centres d’intérêt et des activités parfois différents, parfois semblables. Nous sommes
travailleurs, salariés, chômeurs, étudiants, branleurs assidus à certaines heures, lutteurs acharnés à
d’autres, un peu des deux le reste du temps.
Nous avons un point commun, celui d’être tous exposés dans des mesures assez similaires à un sentiment de malaise aussi profond qu’insaisissable. Nous avons longtemps contenu ce malaise dans un champ de l’intime, dans un univers privé et particulier qui nous appartenait, comme quelque chose d’isolé et de spécifique, une manière parmi d’autres d’être au monde, une tare marginale qui nous aurait pris comme ça, un jour, comme par magie. Et puis le temps et les rencontres on fait leur travail : nous ne sommes visiblement pas seuls.
Il est stérile et dangereux de penser sa situation particulière sur un mode psychologique, d’aller chercher les réponses en soi, dans son cursus d’expériences personnelles, alors que bien souvent, nos régimes de vie, nos conditions sociales, nos ressentis ne sont que les manifestations localisées et particulières de processus et de phénomènes bien plus larges dans lesquels nous baignons sans vraiment nous en rendre compte. Il ne faut pas se condamner à la solitude péremptoire d’être des « cas ».
Notre désespoir n’est qu’une des infinies facettes d’une misère contorsionniste qui emprunte des détours et invente sans cesse des stratégies pour se faire oublier, pour se rendre impalpable et discrète.
Ce qui se passe, tout simplement, c’est que nous sommes pauvres. Nous sommes au centre d’une entreprise de dépossession généralisée : nous perdons nos moyens. Par moyens, il faut entendre moyens d’action. Nous sommes de moins en moins enclins à agir. La précarité et le chômage, comme nos parents et nos grands-parents souvent, nous enferment chez nous, nous assujettissent à des univers sociaux dont nous ne pouvons plus nous extraire, nous immobilisent, nous rendent prisonniers. Pas les moyens de bouger, d’aller voir ailleurs, pas les moyens de sortir, de s’expatrier. Nous manquons de ressources matérielles, mais aussi de ressources cognitives. Nous n’avons pas les moyens de comprendre. Les choses se complexifient, elles se font de plus en plus abstraites, impénétrables. L’information coule à flots, elle nous transperce, nous traverse, nous submerge sans qu’on en retienne le moindre sens, la moindre connaissance utile. Pleins et vides à la fois, nous sommes démunis.
Et avec la confusion, en nous s’immisce la peur. Le problème est que nous ne contrôlons plus notre environnement, son fonctionnement nous échappe. Nous sommes en situation d’errance, à tâtons dans un univers abscons dont nous avons perdu les clés, les notices, les plans.
L’incompréhension intimide, elle produit de la prostration et du renoncement. Et elle alimente les croyances. Les objets sont terrifiants parce qu’ils ont le dessus sur nous, parce qu’ils nous dépassent, parce qu’on ne parvient pas à reconstituer leur gestation, leur processus de confection et de mise au monde. Le ciel accouche d’eux. C’est ainsi qu’ils se chargent d’une aura, qu’ils deviennent des fétiches, des entités magiques, qu’ils s’animent. C’est une réconciliation progressive avec un mysticisme séculaire, une manière de marcher sur les traces de nos ancêtres, d’invoquer Dieu pour le transposer en chaque chose. Mais c’est un rapport au monde qui est aliénant, qui fait de nous de la pâte molle politique, de la chair à canons électorale, des réservoirs de bêtise à disposition d’une économie qui instrumentalise et exploite nos pulsions, notre peur, notre ignorance.
La peur isole, elle bouche les artères de la communication, de l’échange, elle bloque les voies d’accès à l’autre, elle le rend monstrueux et étranger. Elle nous pousse à nous retirer dans nos espaces privés, dans nos zones de sûreté. Nos phobies chroniques nous rendent fatalement solitaires.
Si tout le monde savait comment fonctionnent les objets dont il use mécaniquement à longueur de jours, qui les conçoit et qui les assemble, quels sont les effets périphériques des leviers qu’il enclenche et agite, quelles trajectoires empruntent les produits qui circulent au coin de sa rue avant de s’installer, innocents et vierges, dans la décor muet de son cadre de vie intime, à qui ils ont apporté la misère et qui ils ont enrichi ; si chacun savait comment ses habitudes de vie, ses réflexes, ses rituels quotidiens s’enracinent dans une histoire, qu’ils sont le produit d’une socialisation et pas un invariant culturel, un absolu, une donnée éternelle, certainement notre société produirait-elle moins de monstres terrifiants et informes, moins de racisme, moins de haine gratuite et incontrôlable.
Il est aisé d’apercevoir l’état de désemparement et de violence subie dans lequel une majeure partie de la population se trouve, dans quel misère nous sommes enlisés, au fin fond de quel trou noir nous nous débattons. Dépression, psychose et alcoolisme généralisé au programme de tout un siècle, tous profils sociaux et toutes générations confondues.
Pourtant, si ce régime de pauvreté ordinaire a la faculté d’immobiliser les individus, de diffuser la complaisance et le renoncement, de figer le monde dans un status quo de moisissure sociale et d’aliénation, il semble aussi produire des stratégies d’adaptation et de subsistance, des méthodes.
Tous les jours, nous apercevons des tentatives, des essais furtifs, des prises de risque. La pauvreté a deux visages. Elle a ce pouvoir puissant de forcer la main, de pousser à l’acte parce qu’elle ne laisse pas le choix. Bien souvent, malheureusement, cette absence de choix se traduit par une soumission totale à l’Emploi et à l’obligation de « gagner son pain ». La nécessité de vivre -« il faut bien manger »-, la récompense et le « mérite » cyniquement octroyés au travailleur pour son effort servent de justification permanente à une existence vide et misérable, à un délaissement sans trêve.
Cependant, il nous a semblé, pour l’expérimenter nous-mêmes dans une certaine mesure, que cette nécessité et cette absence de choix portaient en eux l’éventualité d’un revers moins stérile et moins ruineux, et qu’ils pouvaient même peut-être constituer le point de départ d’un parcours d’émancipation, la source d’une possible autonomie à (re)conquérir.
L’indétermination, le doute, l’instabilité nous exposent parfois à des situations nouvelles, nous poussent à nous frotter à de l’inédit, à expérimenter des gestes, à inventer des contacts. Sur le tas, par dépit. Et puis parfois, progressivement, ces contacts forcés se transforment en expéditions libres, en explorations consenties, en conquêtes délibérées.
Faute de moyens, il faut parfois en inventer, en provoquer. Par chez nous, on a vu des révolutions individuelles s’aménager sur une fin de mois difficile, sur un moteur qui serre, sur un ampli qui crame, sur des parcours refusés, des chemins interdits, des routes barrées, des autoroutes payantes et définitivement bien trop chères. On a vu des gens prendre ce pli de faire les choses eux-mêmes, de confectionner leurs propres outils, d’inventer des abris, de mettre des moyens en commun pour créer du mouvement là où il n’y en avait pas, ou pas comme ils le voulaient, on a vu des espaces s’aménager et prendre forme, des collectifs s’assembler pour réfléchir et imaginer des plans d’action, des recoins sombres prendre soudain vie, des objets et des lieux être détournés de leurs fins initiales pour accueillir des fonctions et des activités nouvelles, des granges et des sous-sols se changer en salles de concert, en ateliers, en chambres d’amis, des institutions et des machines être employées à rebrousse-poil, des stratégies opératoires se mettre en œuvre avec d’autant plus de mesure et de justesse et qu’elles naissaient dans l’urgence et la nécessité. Du véritable savoir se produire, en somme.
Une fois arrivé à bout de résistance, une fois qu’on ne peut plus fuir, qu’on est parvenu à la limite de ses propres retranchements, on est contraint d’aller au devant des choses pour les déconstruire et les démystifier, pour se les approprier. On s’émancipe de la force magique et tutélaire d’un objet dès lors que l’on s’y frotte, dès lors que l’on cesse de se complaire dans l’appréhension et l’intimidation, dès lors que l’on va à son devant pour parvenir à le comprendre, à le saisir.
Et puis l’idée nous est tout de même venue que cette audace, que cette capacité à aller au devant des choses, à se construire des espaces d’autonomie ne devait pas rester un demi-mot, quelque chose de secret et de marginal, qu’on devait à tout prix éviter d’en faire une poésie sociologiste, une esthétique abstraite, de l’étouffer dans une fausse mystique de la « résistance » ou dans la légende vaporeuse et naïve d’un peuple savant malgré lui. Parce qu’on ne changera pas nos vies en se chuchotant des histoires.
Ce sens de l’autonomie, cette disposition vitale à prendre le monde à bout de bras, nous devons en dégager des mesures d’action pragmatiques, nous devons en parler, le revendiquer ; nous devons en diffuser la conscience et l’ériger en fait absolu et définitif.
Le constat doit s’imposer que les temps changent, que nos besoins et nos outils changent, que nous avons à notre portée des moyens d’action nouveaux qu’il s’agit d’appliquer à notre mesure et à nos échelles respectives, de mettre au travail.
Nous devons nous reconstituer une audace politique, une inclinaison à entreprendre, un sens du contact.
Il ne s’agit pas d’invoquer un « bon sens » inné qui se serait assoupi en nous, une faculté « naturelle » de juger bien au premier coup d’œil, une lucidité automatique que nous aurions perdue et qu’il faudrait ranimer. Non, il n’y a pas de bon sens, rien ne va jamais de soi. Tout est à construire, tout est à aménager et c’est un travail fastidieux et de longue haleine.
Il ne s’agit pas non plus de réinventer l’école et de convoquer des précepteurs, des savants, des avertis pour dispenser un savoir, comme si le sens des choses était univoque et les réponses aux problèmes fixes et uniques. Comme si il y avait un savoir et une manière de le produire.
Il s’agit, au contraire, d’apporter des réponses spécifiques à des questions spécifiques, à des problèmes circonstanciés et localisés qui nous appartiennent, à des obstacles qui ne sont ceux de personne d’autre, et surtout des réponses qui émanent d’un travail de recherche que nous pouvons entreprendre et diriger nous-mêmes, sans se laisser dicter un emploi adéquat du monde, sans se voir imposer une histoire absolue et sacrée qu’on écrit à notre place, sans laisser notre bouche être remplie par ce flot de paroles ininterrompues qui ne font sens que pour ceux qui s’emploient à les bafouiller.
Nous sommes les seuls à pouvoir analyser proprement les situations que nous traversons, à prendre des mesures d’action sur nos vies. Nous devons devenir nos propres prescripteurs. Nous ne pouvons plus abandonner nos choix et nos actes aux savants et aux experts, aux médecins, aux sociologues, aux économistes, aux ingénieurs, aux techniciens politiques qui s’improvisent en penseurs privilégiés de nos quotidiens et qui prétendent pouvoir comprendre à notre place.
La recherche est prise dans un étau idéologique entre, d’une part, une conception économiste qui en fait l’instrument fondamental d’un productivisme et d’une croissance industrielle infinis, lové dans l’univers secret et défendu des grandes écoles et de l’ingénierie, et, d’autre part, une tradition intellectuelle qui cristallise la production de savoir dans un écrin sacralisé de « gratuité » et de désintéressement, gardé par une classe complaisante de cadres moyens, de chercheurs universitaires et de professeurs, émissaires d’une connaissance « pure » et sans autre fin qu’elle-même. Deux exercices du savoir qui, dans leur antagonisme apparent, concourent de toute manière à reproduire les structures de pouvoir en place et la répartition sociale des possibilités d’action.
Si toutes les initiatives qui ont prétendu restituer à un quelconque « Peuple » les outils et les clés de son autonomie n’ont finalement réussi qu’à s’user et à pourrir lentement ou bien à devenir des entreprises complètement opposées dans leurs actes à leurs principes initiaux, sans jamais toucher du doigt la substance réelle de la mission salvatrice sont elles s’étaient alors vaniteusement chargées, c’est que, dans cet acte même de « restitution », dans la prétention à offrir, à fournir, à administrer, elles transportaient d’emblée avec elles les relents d’un mépris masqué et l’indisposition formelle d’apprécier à sa juste valeur l’intelligence, pure et simple, de tous ces gens.
Des élans les plus sincères de l’Éducation populaire aux grossiers fétiches de la « Démocratie culturelle » éparpillés dans nos supermarchés et nos salles de classes, il n’y a guère qu’une docte ignorance qui s’est démocratisée, une disposition à déglutir sans jamais rien assimiler du contenu lourd et indigeste qu’on se voit servir sans interruption par une main maternaliste et providentielle.
La « culture populaire », concept-jouet d’un savoir édicté par des institutions dominantes et arme ultime d’une bourgeoisie facilement émue par les fables qu’elle se chuchote à elle-même, n’a jamais été la propriété de ceux qui en sont les détenteurs supposés. Cette culture de romans s’impose comme le prétexte et la justification d’une ascendance éternelle des faiseurs de rêve sur les esprits rêveurs. Et son substrat artificiel ne retombe jamais dans nos gueules asséchées que sous l’état d’une pluie de poussière insipide et informe, comme les restes d’un vieux fruit écrasé par une main trop puissante.
Nous ne sommes les propriétaires que de nos propres mots. Sans un langage qui soit le nôtre, nous sommes condamnés à être parlés par d’autres.
Vivien (Medication Time / Coping)


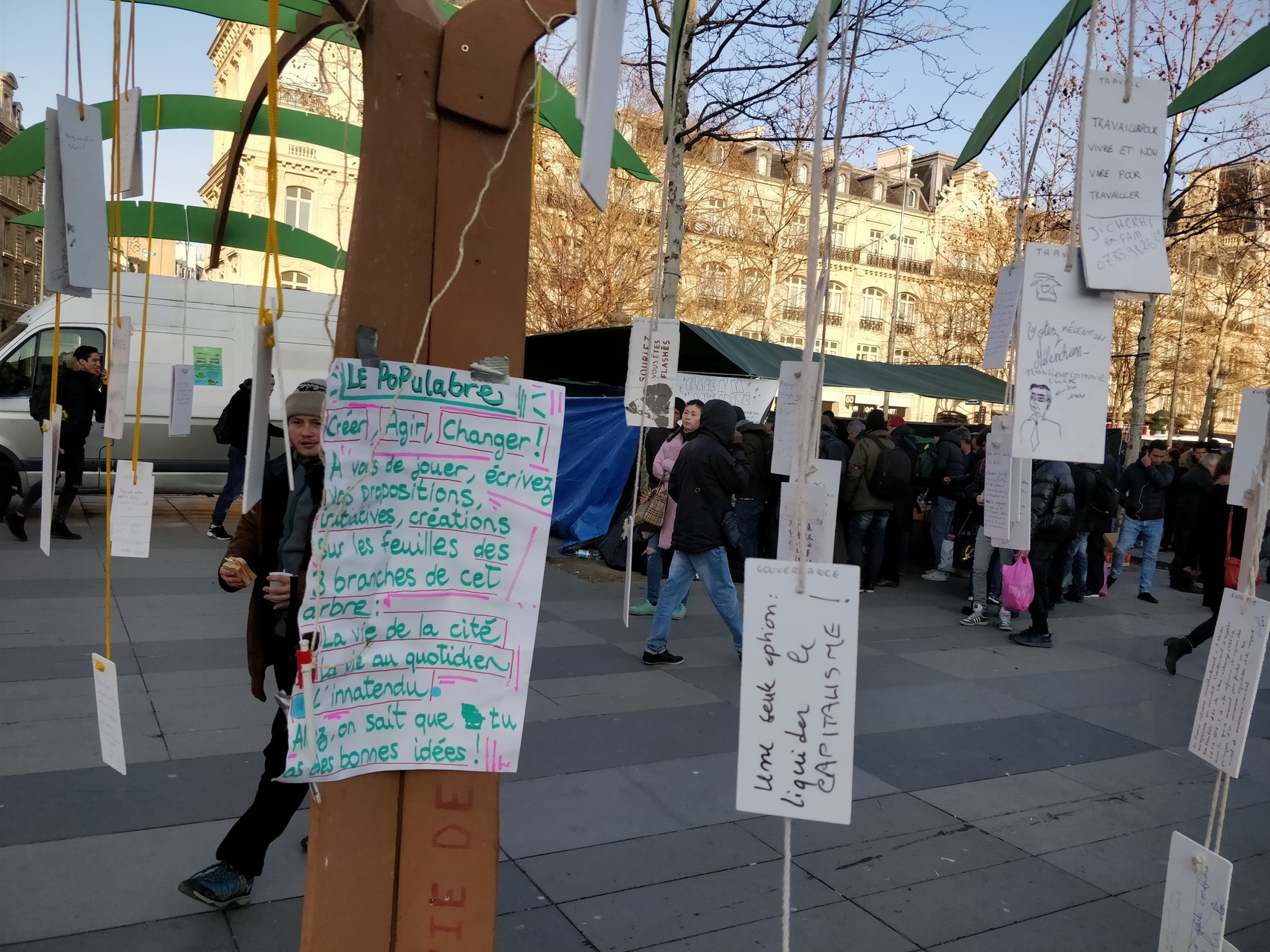
1 commentaire
DELAGE Jean Louis · 16 septembre 2014 à 13 h 41 min
Bonjour…
Je viens de lire ce texte. J’aimerai qu’il en émerge un projet. Pour ma part, je suis un retraité récent et disponible à l’action comme à la réflexion. Je pense par ailleurs que l’on réfléchi aussi dans l’action.
Je suis tulliste, de Lagarde-Enval, pour être plus précis. Je suis aussi engagé dans la vie associative (culturelle, sociale) depuis plus de 40 ans.
Aujourd’hui, la situation est grave… mais pas désespérée( si volonté nous avons!).
Je propose une première idée, un apéro/philo. régulier à Tulle (Bar « le Lovy ok). Au delà des échanges directs et libres, c’est de rencontres véritables dont nous avons tous besoin. de reconstituer nos capacités créatrices, nos capacités de révolte dans un contact direct. Je ne suis pas de ceux qui misent sur la toile, le « cloud », et la téléphonie magique pour la reconquête de notre liberté, de notre avenir! Je suis de ceux qui aiment et pratiquent la rencontre la confrontation directe et vivante, l’émergence d’idées nouvelles!
Peut-être une réponse?
A bientôt
Jean Louis Delage
Les Fontanelles
19150 – Lagarde Enval