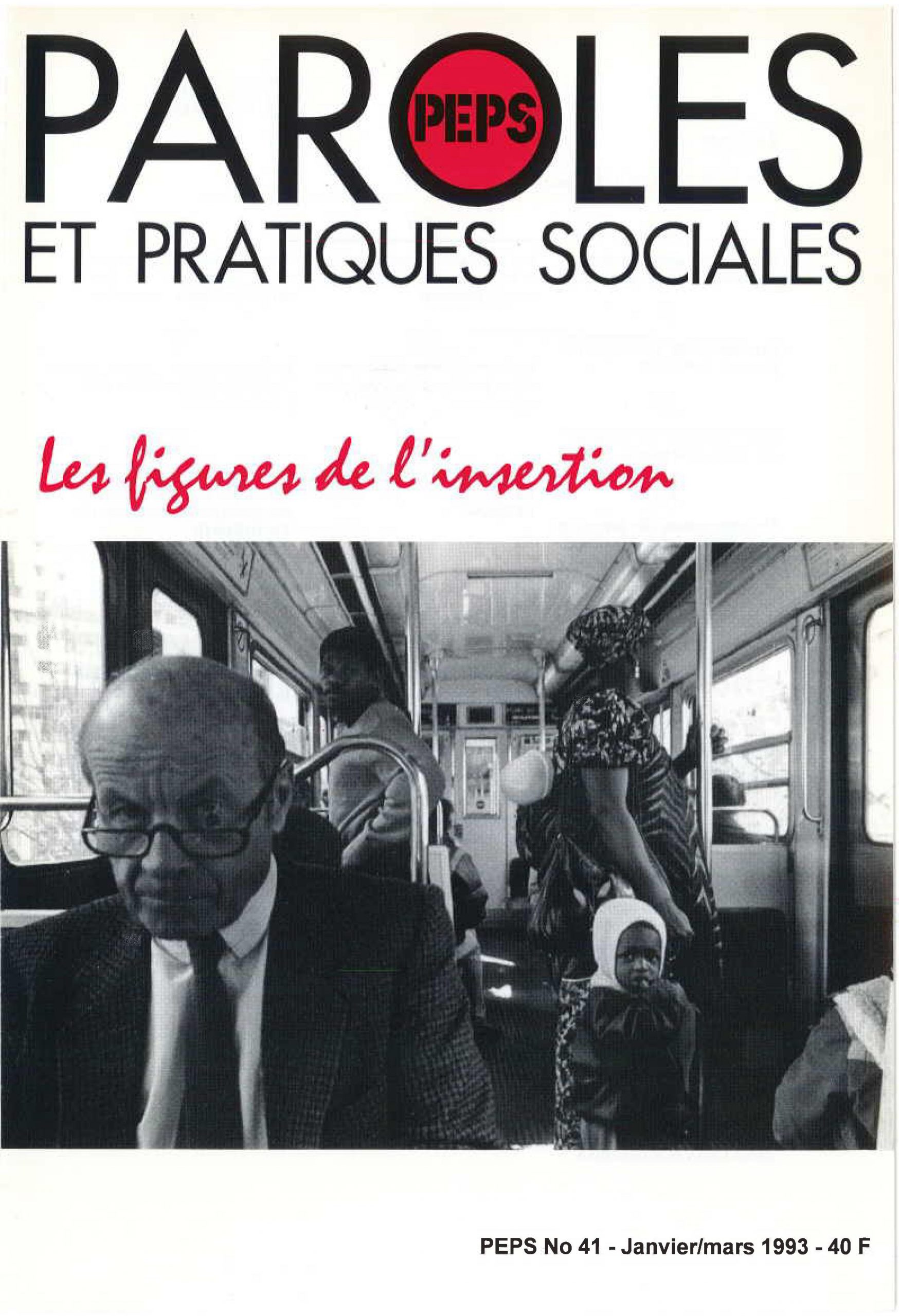(suivi par « le mémoire » de Béatrice MARINONI)
L’écriture professionnelle en travail social débute dès la formation. Quelle expérience en retirent les étudiant(e)s sortant des Instituts de travail social, quelles représentations en ont-ils et finalement quel est leur rapport à l’écriture ? C’est ce qu’il semblait nécessaire de demander aux intéressés, mais, en engageant la conversation sur ce sujet, on obtient aussi d’autres informations sur la profession.
« TOUT LE MONDE EST CAPABLE D’ÉCRIRE…
…et pourtant j’ai toujours été enfermée dans le rôle de quelqu’un qui avait du mal à écrire et je crois que ça reste longtemps. Par contre, dans une formation à l’expression écrite qui durait trois jours, une femme nous a démontré qu’on était capable de faire quelque chose et ça, je m’en suis souvenue.
Je crois qu’elle a réussi à mettre en valeur notre créativité, en fait, chacun à son niveau, elle nous avait fait faire des exercices, écrire une phrase sans « etc. » Elle nous avait intéressés avec R. Queneau. Elle m’a passionnée pendant trois jours et, à la fin, et je les ai gardé ces écrits-là, je les ai relus il n’y a pas longtemps et je me suis dit c’est génial I Elle était arrivée à faire que je sois contente de ce que j’avais écrit, pour la première fois…
En ce qui concerne mon mémoire, je ne suis pas trop mécontente de ce que j’ai écrit, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que c’est un bon point : on est plus capable de soutenir quelque chose quand on est content. J’ai eu du mal pour le premier mémoire, je ne l’aimais pas ce mémoire, ça ne m’a pas plu, j’ai travaillé contre le sujet, je l’ai détesté ce mémoire !
ON EST RECONNU PAR L’ÉCRIT
Je me sens plus à l’aise à l’oral. Justement une AS me disait qu’une grande majorité des travailleurs sociaux ont énormément de problèmes d’expression écrite et s’accomplissent énormément à l’oral ; ils parlent beaucoup et écrivent peu. Je pense qu’ils ont des bonnes idées, enfin « ils ont », ce matin je me suis dit : on pense « les assistants sociaux », en fait on est tous différents, c’est une façon de parler et de classer. Il y a des idées, mais elles restent en l’air et sont récupérées. J’ai ce sentiment-là, c’est justement le blocage de l’écriture. Il y a aussi l’angoissante question « comment faire ? » et puis, dans le social, on est peut-être plus dans la réflexion que vraiment dans l’agir. Je crois que ça se sent bien dans les relations humaines, les revendications. C’est vrai que lorsqu’on se revendique on est reconnu par l’écrit. Je pense qu’aujourd’hui le travailleur social n’est pas reconnu parce que ce ne sont que des paroles et pas des écrits
Quand je regarde la formation, les amies qui étaient dans ma promotion, il n’y en a pas beaucoup pour qui ça a été simple d’écrire, on l’a tous plus ou moins décrit comme une horreur, comme une chose très difficile.
J’ai discuté avec des troisièmes années que je ne connaissais pas tellement l’an passé. Ils sont venus me voir en me disant : « ça y est c’est recommencé, tu l’as refait ! » Je me suis rendu compte qu’ils avaient exactement le même effet panique que moi. Qu’est-ce qu’un mémoire, C’est quoi cette bête-là qui doit faire à peu près cinquante pages ? On nous dit qu’il faut démontrer quelque chose, mais en définitive on ne peut pas non plus mettre « je », quelque chose qui reste quand même assez flou.
PRENDRE PLAISIR
Pour réussir un mémoire avant tout il faut l’aimer et il faut prendre plaisir à le faire. Dans le cas contraire je pense que ça ne donne pas de résultat, en tout cas, le résultat dont on a envie. La preuve en est que mon premier mémoire, je l’avais commencé en décembre, je l’ai fini en mai…avec quatre kilos en moins ; ça a été très mal, ça a été la crise d’identité professionnelle et personnelle. Et là, je n’ai pas repris une seule ligne de l’ancien mémoire et c’est vrai que j’ai commencé le premier écrit le 2 septembre et donc je l’ai rendu en un mois et dix jours, j’ai écrit cinquante pages, alors que pour l’autre j’ai mis quatre-cinq mois à en écrire trente-cinq et encore j’avais tiré…Ce qui me fait dire que, quand on aime quelque chose, ça marche ! Quand on sait surtout pourquoi on le fait et quand on sait à quoi ça ressemble aussi.
J’ai eu le sentiment de manquer de soutien pour le premier mémoire. A l’institut, on a quinze heures et un formateur. Et moi je leur avais dit que l’idéal c’était d’avoir sept heures avec un formateur pour une formation théorique et sept autres heures où, en fait, on pourrait discuter de la façon dont on voit son mémoire
PROJET D’ECRITURE PROJET PROFESSIONNEL, CE A QUOI SERT LE MÉMOIRE
Est-ce que, effectivement, on a un véritable projet avant d’écrire un mémoire ?Je pense que j’en n’avais pas. C’est clair, avant d’écrire le premier mémoire je n’avais pas de sujet, il n’y avait rien qui me passionnait vraiment, ça a déclenché, d’ailleurs, certaines questions. Je n’avais pas de projet d’écriture pour le mémoire et surtout, je ne savais pas ce que je voulais, ce que je voulais faire à travers cette profession-là.
Finalement je n’ai pas eu ce premier mémoire et j’ai été déçue parce que c’est vrai que, quelque part je comptais sur la chance et puis j’avais tout de même fourni un certain travail je veux dire sur 35 pages tout n’était pas bien mais tout n’était pas mauvais non plus. Je me suis donné une échéance pour prendre une décision : soit j’arrêtais ma formation, soit je la continuais, je crois que de toutes façons ça devait passer par là. Et j’ai décidé de continuer, mais j’ai surtout décidé de laisser derrière moi l’ancien mémoire, pas en annulant complètement ce qui s’était passé parce qu’au contraire je m’en suis servi pour l’autre, mais je me suis dit : je sais pourquoi je vais continuer, je sais à quoi va servir mon mémoire et je ne me suis plus posée de questions à ce moment là
CE OUI FAIT QU’ON ÉCRIT : LA CONFIANCE EN SOI
Je crois que j’ai repris confiance. Ce qui m’a aidée, c’est que j’ai lu d’autres mémoires et je me suis rendue compte que les gens écrivaient d’une façon relativement simple avec un point, on retourne à la ligne, on dit une autre idée et j’ai essayé, en fait, de clarifier ce que je pensais et forcément de clarifier ce que j’écrivais.
J’ai clarifié ce que j’écrivais à partir du moment où je clarifiais ce que je pensais et surtout, j’avais quelque chose à dire parce que je pensais quelque chose. L’écriture arrivait comme le prolongement de la pensée, alors que jusqu’à présent j’avais des pensées, mais elles s’arrêtaient à un moment où je ne devais pas avoir envie de le dire, je ne communiquais pas, ce n’est pas facile à exprimer…
CE QUE REPRÉSENTE LE MÉMOIRE : UN POINT DE DÉPART DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Le premier ressemblait à un outil qui me permettait d’avoir un diplôme, le deuxième ressemble à un écrit qui reste et qui peut servir d’autres, qui peut servir de point départ. Un écrit où il y a des idées qui sont les miennes, qui sont écrites à ma façon avec une orientation qui est la mienne, mais qui peut servir de point de départ pour quelqu’un qui n’en a pas. Un écrit qui reste une trace, alors que le premier, pas du tout. Le premier, c’était un mémoire que l’on me demandait de faire et qui devait rassembler quelques pages pour avoir un diplôme
Je pense qu’il faut écrire quelque chose qui, d’un point de vue professionnel, peut avoir de l’intérêt et à côté, faire une formation qui soit plus en rapport avec l’institut.
ÊTRE PUBLIÉE
J’ai le souvenir, dans un colloque, d’une fille qui avait écrit un mémoire en rapport avec un projet sur le lieu de son stage et son mémoire avait été primé. Je pense qu’il est bien de savoir que son mémoire ne va pas être mis sous une pile et puis, en définitive, jamais consulté, parce que dans un mémoire, on y met des choses du temps, on y met du cœur, on y met de la haine, on y met, en tout cas, de soi.
Faire un article, ça me plairait bien. On avait un peu fait cette démarche avec le projet Tchécoslovaquie. On avait eu de l’argent par les ASH et, en contrepartie, on devait leur renvoyer un article, ce qu’on a pas fait. Je le regrette parce que c’était quand même le projet de départ et on ne l’a pas réalisé, c’est pas sympa. Il faut voir aussi que, généralement, on démarre un projet à 6 comme on l’a fait, que le voyage c’est la carotte et que lorsqu’on a mangé la carotte, généralement on ne se retrouve plus qu’à deux. Donc écrire le projet et en plus, écrire un article d’ASH, ça faisait beaucoup, surtout au moment où on démarrait le mémoire ! C’est aussi un concours de circonstances mais, par rapport à ce que j’ai vu en Tchécoslovaquie, j’avais beaucoup de choses à dire Moi je trouverais ça génial d’être publiée pour donner des orientations aux autres. J’ai le souci de communiquer ce que je vois, ce que je fais pour avancer et en même temps aider certains à un moment donné
EN COULISSE DU MÉMOIRE…
J’ai été énormément choquée, quand je suis allée à la DRASS passer ma « situation sociale ». Il y avait une femme qui s’est mise à discuter avec un collègue, devant moi, comme ça, je ne la gênais pas a priori, elle lui a dit : « Je suis embêtée, je n’arrive pas à fourguer un mémoire ; je l’ai proposé à une psy, elle ne voulait pas, je l’ai proposé à une AS, il a fallu le lui envoyer mais comme c’était la fin du week-end, elle n’en voulait plus il a fallu aller le rechercher ». Je me suis dit : il est où, le respect du travail, il est où, dans ces conditions-là ? J’ai été outrée de voir qu’on n’en tient pas plus compte que ça.
J’ai discuté avec une amie et je me suis rendue compte que les 3ème années on a tous des sujets qui se ressemblent et une entraide est possible : tiens, tu devrais voir intel qui a fait son sujet là-dessus, regarde sa bibliographie, regarde son orientation ! ou : tiens, tu parles de sa conclusion, va voir ce qu’il en pense ! En définitive, ce qui se passe, quand tout le monde a eu son diplôme : on fuit l’Institut. Il y en a même qui sont venus rechercher leur mémoire, c’est peu dire….
Je crois qu’on a tous besoin, à un moment donné, que celui qui a fait un mémoire avant nous et qui a une orientation et une bibliographie en rapport avec ce qu’on fait, et nous en informer, mais je crois qu’il y a un côté très protectionniste part rapport à ce mémoire.
ÉCRITURE COLLECTIVE ? QUELLE SOLIDARITÉ ENTRE ETUDIANTS ?
Je sais qu’une amie avait fait son mémoire de psychologie, sa licence : elle l’avait fait avec une copine , je pense que c’est rassurant, je pense que c’est même bien ! parce qu’il n’y a pas simplement son enjeu , mais il y a l’enjeu de l’autre, je pense que c’est bien.
Par contre, à l’Institut, je n’ai pas travaillé une ligne avec des gens. Je suis incapable de dire de quoi traite le sujet d’une fille de ma promo qui a été recalée comme moi sur le même thème. Pourtant j’ai eu l’occasion de parler un peu avec elle : sur quoi travailles-tu ? Et je n’ai jamais eu de réponse. Je sentais bien que c’était « son travail », « me pique pas mes idées ! » J’avais l’impression de me retrouver à l’école primaire, des fois que ses propres idées fassent progresser les autres, vous vous rendez-compte ! J’ai senti la formation comme un véritable individualisme, surtout pour le mémoire, à un moment où on pourrait penser qu’on a vraiment tous besoin des autres.
MAL ÊTRE DANS LA PROFESSION
En écrivant mon mémoire, je me suis positionnée, par rapport à la profession, seulement je ne savais pas si j’allais continuer ou arrêter parce que j’ai été souvent agacée par tous ces travailleurs sociaux qui râlent, qui râlent, qui râlent à propos d’une profession et qui, en définitive, l’exercent quand même.
Et cette profession elle n’est pas à crier dessus parce qu’en fait, elle les fait vivre c’est une source alimentaire (pour les travailleurs sociaux comme pour les usagers) et j’ai fait le pari d’être cohérente avec moi-même. Je vais avoir mon diplôme, je vais exercer cette profession-là, mais je l’exercerai avec le sourire et je crois que dès que je commencerai à être revancharde et désagréable, j’essaierai d’arrêter et de faire autre chose parce que je pense que les usagers sont des gens qui, la plupart du temps, viennent chercher une aide, quelle qu’elle soit et trouvent en face d’eux des gens complètement dépressifs dans leur façon d’être et de faire. Donc par rapport à ça c’est par respect et puis, deuxièmement, c’est une profession qui ne peut ne plus correspondre à une personne à un moment donné. Je crois que les assistants sociaux ronchonnent pas mal de leurs conditions et sont dans le paradoxe justement de ne rien faire pour ; c’est vraiment la solution de facilité. Il y a une dignité qui fait qu’on part parce que ça ne correspond plus, on arrête.
Comment peut-on être dépressif dans une profession où, en plus on démoralise les stagiaires ? On risque de communiquer un désarroi total aux autres. A un stagiaire, c’est pas trop grave, mais à une famille je trouve ça honteux. Je me sens concernée par les problèmes de société, mais de plus en plus aussi par les problèmes de statut, de reconnaissance.
CRISE, RUPTURE, QUELLES SOLUTIONS ?
Je crois que plus on se dit qu’il y a une crise, plus en fait, on trouve la solution facile de dire : « oui mais on est en crise » mais en définitive on est toujours au résultat et aux causes et je pense que pour une situation, par exemple ou une famille en difficulté, les résultats c’est effectivement un point de départ mais le but, c’est quand même de régler la cause, je pense que par rapport à la problématique de la reconnaissance des travailleurs sociaux et leur façon de travailler, je pense qu’une fois de plus, il faut arrêter de crier sur les résultats et voir la cause. Et c’est pour ça, cette fameuse crise d’identité, je pense qu’elle est plus complexe que ça, c’est sûr, mais je pense que c’est aussi facile de se dire qu’on est en crise et de se cacher derrière ça et de ne rien faire non plus !
Je n’ai pas l’impression justement que cette « crise » est appréhendée comme une rupture mais comme un long état qu’on gère et dans lequel on se trouve, tout compte fait, bien parce que ça nous permet de justifier les choses qu’on ne fait pas. C’est un truc complétement bizarre et moi je ne m’y reconnais pas. Alors je pense que je vais être vraisemblablement malheureuse dans les services dans lesquels je vais tomber, mais je me dis tant pis…
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Je vais avoir un poste en polyvalence de secteur. Moi qui ne voulait pas en faire, je m’y retrouve. J’avais l’impression que c’était ce qui me déplaisait le plus, en fait, c’est ce qui m’a le moins déplu. La polyvalence de secteur c’est peut-être là que j’arriverais à tenir ma place par rapport à moi-même.et par rapport aux usagers aussi et après, je pense, je me sens beaucoup plus proche de la formation : essayer de faire passer des choses que j’ai ressenties. Et sur le mémoire, par exemple, des crises à certains moments, sur l’écriture, sur les grandes questions, sur la profession, si on a envie de la faire, si on a un projet, faire remonter plein de choses…
Il me semble avoir compris en fout cas pas mal de choses par rapport ma non-réussite et ça, j’ai envie de le communiquer. Ce que je disais aux Sèmes années : reste encore la difficulté qu’on est, chacun, complètement différent, la façon de vivre les choses avec une personne ou toute seule. Comme je suis, avec mes qualités et mes défauts je l’ai vécu comme ça, j’ai ressenti ça, maintenant chacun s’y retrouve ou s’y retrouve pas.
En recommençant le mémoire, j’ai eu l’impression d’avoir retrouvé justement le but Quand on vit quelque chose à fond et on en reste pas à la conséquence et quand on fait un travail sur le pourquoi du comment, un cheminement par rapport à ce qui s’est passé, et bien ! Je pense qu’on a appris plein de choses et qu’à partir de ce moment-là on peut en faire bénéficier les autres. J’essaie d’expliquer avec le plus de précisions, parce que, ça aussi, il m’a semblé que les TS parlent d’une façon très très vague et quand on veut se faire reconnaître, il faut être très très pointu et faire attention à son vocabulaire. Et c’est pour ça qu’en discutant avec les Sème années je crois que j’ai essayé d’être très précise, d’employer un mot plutôt qu’un autre. Quand je voyais qu’ils essayaient d’interpréter à leur façon un mot je leur donnais la représentation du mot que j’employais et c’était génial !
-C’est déjà un travail d’écriture ça !
-Mais complètement ! Je crois que j’ai senti le déclic : chacun ne met pas les mêmes choses derrière un mot, je crois que l’important justement c’est que l’écriture fasse corps avec le réel’.
Laurence Millet *
Propos recueillis par Jean-Luc Dumont
* A.S. en polyvalence de secteur. Vient d’obtenir son diplôme. Pour toutè réaction ou demande d’information, écrire à PEPS qui transmettra.
Le Mémoire
- 6h00 du matin, le réveil sonne… Mon mémoire !
- 7h30, je monte dans le train… Mon mémoire !
- 9h00, MONTROUGE…Salut les copines ! Votre mémoire !?
- 12h00, Direction la cafétéria… Mon mémoire !
- 16h30, A demain les copines, Bossez bien…Votre mémoire !
Et c’est ainsi pendant des mois et des mois…
Métro, boulot, dodo ? NON, NON…
Objet, Problématique, Hypothèse !…
Crises d’angoisse : j’y arriverai pas.
Bouffées d’espérances : j’y arriverai !
Qui va le taper ? Je tape…Non je ne pourrai pas !
Oh ! Et puis si…Et puis non, je le ferai taper !
Bon, j’en suis pas encore 1â !
2h00 du mat, cauchemar : recalée au D.E.
Mauvais rêve. J’y suis pas encore !
50 pages…Il faut que j’écrive 50 pages !
On sort ce soir ? Tu rigoles ! Faut que je pense au mémoire !
Oh ! Horreur : avril… faudrait peut-être que je m’y mette ! ! !
Béatrice MARINONI
A.S. 3ème année