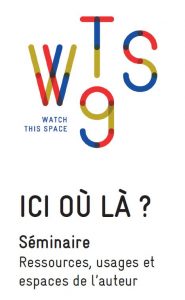Qui est créateur d’espace ? Est-ce que le graffiti
dégrade ? À qui appartient l’espace public ? Ici se jouent des luttes
de pouvoir à travers le contrôle de l’espace et la production du savoir. Nous
essaierons d’éclairer le sens d’un « art en espace public »,
profitant de la rencontre avec Jeax, Popay et Alex, artistes graffitis,
peintres, muralistes, designer.

Esthétique
impure ou contrôle de l’espace ?
Il est reproché couramment au graffiti de détourner les
supports muraux, de déranger de manière peu esthétique l’espace public.
Inversement nous pourrions défendre le rôle de l’espace public d’être le
forum-critique où s’expose un problème qui interroge la collectivité ?
À ce titre nous nous intéressons au graffiti hip-hop (tag,
graff)[1] qui doit sa
diffusion sur la planète aux réseaux métropolitains, lieux de brassage, de
rencontres et d’expérimentation d’un « art en
transit ». À travers des parcours biographiques originaux, la mobilité
(du support, de l’artiste, du public) participe à l’œuvre et à la définition
non patrimoniale de l’art et de la ville.
L’esthétique qui se dégage du graffiti hip-hop ne peut être
séparée de la vie sociale. Le sens de cette totalité se construit en situation
avec d’autres, et contribue à urbaniser l’espace en le rendant public. En cela,
le tag appartient au même mouvement que le spray can art.
Jeax : Il y a toujours dans le graffiti cette ambiguïté entre être compris et échapper. Dans l’écriture, il y a une double dimension entre une image simple et des lettrages très compliqués ou encore des jeux de couleurs peu évidents. Il y a une envie de séduire, mais de ne pas être forcément lisible. Le tag est une écriture déformée, moins c’est compris, plus le tag à un style. Dans le graff, c’est le même principe, plus tu arrives à une image complexe et jolie en apparence, tu séduis tout en n’étant pas facile à saisir.
Il existe des codes et des validations propres au milieu, un
langage esthétique, un vocabulaire (élémentaire et sophistiqué), une forme
structurée, une histoire, des modes de transmission et d’intervention dans
l’espace public.
Cette performance décale, elle « provoque » (non parce qu’elle est en soi provocante),
mais parce qu’elle interroge le cadre de compréhension des espaces communs et
de ce qui les relie, c’est-à-dire la ville. « L’urgence du geste,
l’authenticité du propos et l’invention qui préside à sa traduction graphique
deviennent des qualités quand la violence et la provocation accèdent au rang de
valeur esthétique. »[2]
Une nouvelle grammaire visuelle ne s’appuie pas
nécessairement sur un message direct et explicite, mais sur une relation à
l’espace urbain en instaurant le principe même de la mobilité comme « relation
publique généralisée. »[3]
Popay : Il y a une tension entre le côté « on veut se rendre lisible » et le côté « tag inaccessible destiné à une intelligentsia du mouvement qui arrive seule à décoder » : Les « persos » (personnages) qui sont facile à lire, style réaliste ou cartoon tape-à-l’œil, qui sont plus accessibles que les wild-style (lettrage déformé). C’est peut-être des pièges pour attirer le regard. Ensuite, la personne peut s’attarder plus sur le déchiffrage des lettres.
Seul l’espace public peut lier ainsi une forme structurée
esthétiquement et structurante socialement comme le graffiti hip-hop et
l’événement qu’il entraîne en tant que configuration de présence ici et
maintenant. L’espace public prend alors un rôle médiateur dans « la
constitution d’un monde commun et dans l’organisation de l’action collective. »[4]
Le souterrain métropolitain est occupé par de nombreuses
personnes. Pour la société de transport, il s’agit d’usagers, pour l’afficheur
publicitaire, de client et pour le graffeur, de public, pris non comme masse
indifférenciée, mais comme ensemble d’individus dont l’attention est
personnellement sollicitée des rencontres se produisent, des paroles
s’échangent, un jugement s’exerce et un nouveau cadre commun de compréhension
s’élabore.
Depuis les années 70, le spray
can art (art aérosol) a pu ainsi jeter ses ancres flottantes dans les
espaces interstitiels et s’inscrire durablement dans le paysage urbain. Mais
aurait-il pu émerger aussi facilement aujourd’hui ?
Popay : cela peut être vu comme une réaction à la société de consommation, de la publicité qui mitraille. Bando disait que ce n’était même plus le sens di mot, mais le plaisir de dessiner la lettre. Est-ce une critique ou juste une répétition de la société esthétique et du pouvoir de l’apparence ? Peut-être c’est une réaction pour redonner du sens aux mots assujettis par des intérêts.
Il y a effectivement possibilité à percevoir directement des
significations, une totalité, un mode d’organisation. Cette relation du
sensible à l’intelligible génère un espace esthétique propre. La forme graffiti
et le sens qu’il provoque par son apparition événementielle sont reliés par une
certaine qualité communicationnelle, moins permanente, plus déliée du territoire.
Mais le graff n’est pas la simple trace d’un passage, c’est une configuration
de l’expérience et donc de l’espace.
C’est une inscription contemporaine qui est représentative
de l’inscription des espaces sociaux dans la modernité et reprise en tant que
telle. La rue n’est pas simplement là où l’on passe, mais là où il se passe
quelque chose que l’on ne contrôle pas.
Nous dépassons la rue et la place classiques pour couvrir de
nouveaux nœuds de communication (dalles commerciales, zones temporaires de transit,
etc.). Dans cette ville intervalle,« le problème n’est pas la distance qui
sépare que celui du lien qui unit dans la séparation. »[5]
Dire que le graffiti crée de l’espace ou au contraire le
détériore, ce n’est pas seulement opposer deux visions esthétiques ou
juridiques, c’est concevoir la ville dans la possibilité ou non d’être formée
par l’espace public. « Certains prétendent que barbouiller des bâtiments
augmente la crainte du crime tandis que d’autres le voient comme une
interaction avec les espaces urbains qu’ils créent. »[6]
Dans les luttes pour savoir qui a la définition et donc le
contrôle, la plus ou moins grande permissivité des espaces urbains constitue un
baromètre démocratique pour la société civile (pas plus que la démocratie,
l’espace public n’est quelque chose de naturel et qui va de soi).
L’espace est un produit social. « Il y a des rapports
entre la production des choses et celle de l’espace. L’espace n’est pas un
objet scientifique détourné par l’idéologie ou par la politique ; il a toujours
été politique et stratégique. C’est une représentation littéralement peuplée
d’idéologie. »[7]
Art
social ou socialisation de l’art ?
L’émergence d’un art populaire n’est pas liée à une
instrumentalisation de l’espace, mais à une création de nouveaux espaces. Cette
force créative s’exerce en situation (interaction, appropriation), justement en
réaction à l’imposition d’une standardisation commerciale. Il crée une
véritable communauté d’intérêts, que l’on ne peut pas atteindre en consommant,
mais en étant soi-même créatif. Cependant demeurent les enjeux publics de
l’art, particulièrement d’un art en espace public. « Espère-t-on de ces
écarts l’ouverture d’un espace critique ? Dans un espace public envahi par
les intérêts privés, acheté par des sociétés pourvoyeuses de fonds pour vendre
leur étiquette et pour soutenir les artistes qui brouillent la communication,
n’est-il pas illusoire de prétendre pouvoir créer autre chose qu’une nouvelle
version de l’art public, mais ne permet pas d’entrevoir ce que seraient
les enjeux publics de l’art ? Y a-t-il un mode de représenter qui serait
public ? »[8]
Jeax : Est-ce qu’il serait possible à l’intérieur du circuit d’image rentable de créer une image « non rentable ». Est-ce que l’on autorise une grande partie de la population d’utiliser l’espace public comme espace d’expression, dans quel cadre et comment ? Est-ce que la société peut être enfin le reflet de ce que l’on est, ou est-ce qu’elle va continuer à être le reflet du schéma de consommation ?
L’art en espace public propose une autre rationalité
économique. C’est donc un art public (intervient dans l’espace public dans un
certain rapport aux publics) qui participe à la création de l’espace qui
lui-même le définit. Nous retrouvons ici les différentes acceptions de « public »
: un mode d’intervention dans un espace physique ouvert, la visibilité d’une
forme travaillée ‘ des personnes participantes à une situation commune
dans un jeu d’interactions, la possibilité de mettre en débat et d’élaborer une
critique.
Alors que l’espace public est vidé de toute interaction
humaine non ordonnée, verrouillée par un système de contrôle, de surveillance
et de savoir, de l’autre un peu de désordre, c’est-à-dire de la vie, est
réintroduit de temps en temps par des manifestations réglementées (fêtes
déambulatoires, art de la rue, raves autorisées, défilés carnavalesques et
autres journées où il est décrété que l’on peut faire la fête).
Alex : On ne sait pas que la « Nuit Blanche » à Paris a été inspirée par le mouvement squat. L’initiative aurait dû partir de là. Les personnes des squats avaient l’habitude de faire des fêtes et ouvrir leurs portes. Nous avons demandé de se réunir avec les autres squats pour une journée collective. La mairie a dit non et maintenant, il débloque des millions d’euros pour faire une nuit dédiée à la fête, à la musique et à l’art.
Quand est-il du rapport spontané, libre, créatif et
imaginatif en dehors de tout cadrage préétabli et rapport hiérarchique ? L’espace
public est occupé par un dispositif de médiation, en particulier de médiation
culturelle qui tire légitimité, pouvoir et financement de cette position.
D’autre part, l’art en l’espace public a trop souvent été
réduit par une visée instrumentale principalement dirigée vers les quartiers
populaires. Cette confusion entre art d’intention sociale (injonction) et
socialisation de l’art (processus) ne peut que mener à l’impasse. Est-ce à la
politique culturelle « d’œuvrer la ville » ou est-ce à l’espace public
de provoquer des émergences culturelles ?
Dans tous les cas, l’art ne peut pas résoudre les problèmes
sociaux s’il n’y a pas d’espaces politiques pour les mettre en débat. Or,
depuis une vingtaine d’années cette dimension populaire n’est pas perçue comme
espace de redéfinition, mais comme enfermement territorial. Ainsi, les
émergences culturelles deviennent paradoxalement le signe d’un « problème »
(le ghetto) alors qu’elles portent en elles-mêmes la solution (ouverture d’un espace
public, modes de socialisation et de transmission, etc.).
Jeax : Qu’est-ce que la fresque et la peinture dans l’espace public ? Elle vient d’une tradition mexicaine, c’est une démarche qui dit, notre peuple , depuis le temps où il a été opprimé, a besoin d’une identité. On prend des gens qui peuvent passer un message et qui peuvent renvoyer cette notion à travers un art qui appartiendrait à tout le monde en prenant la démarche de chacun. Ce n’est pas une instrumentalisation, les artistes ont le pouvoir de faire ou de ne pas faire, ils ont cette envie de passer à quelque chose de collectif et constructif. Est-ce que l’on a envie au début de la démarche d’avoir un art qui permette de créer au niveau public, est-ce que l’on veut cet outil.
Logiquement, la commande d’interventions artistiques ne peut
créer d’espaces publics si l’on ne comprend pas en quoi l’espace public
constitue d’abord le lieu privilégié de la socialisation de l’art.
Jeax : L’argent va dans de l’art événementiel. Mais il n’y a pas de soutien à de l’art qui se construit sur le long terme. Il y a une centaine de murs peints sur Paris. Ils ne savent plus quoi faire des murs. J’aimerais que ces murs deviennent des lieux, des lieux d’expressions qui puissent faire l’objet d’appels d’offres.
Des
espaces « alternatifs » ?
Déjà, retenons cette notion d’expérience comme processus en
devenir non réductible à des « projets », mais comme action
structurée en situation, entre dimension personnelle et sociale, individuelle
et collective, subjective et objective.
Nous y retrouvons le principe du « work in progress »
qui met l’accent, d’une part, sur l’action plus que sur l’œuvre (work)
et, d’autre part, sur ceux qui la réalisent plutôt que sur un auteur identifié.
L’artiste n’impose pas une œuvre, bien au contraire, il la conçoit d’abord en
fonction du site et ensuite avec ceux qui l’aident à la réaliser. C’est ainsi
que l’élaboration en commun fait partie intégrante de l’œuvre.
De même, nous évoquons l’idée d’œuvre « open-source »
et de « copyleft attitudes ». À la différence du « copyright »,
la copyleft est pour le partage de la propriété intellectuelle dans un but non
marchand de développement des ressources par la coopération. La « free culture »
s’oppose à l’industrie culturelle qui soumet l’exploitation de la propriété
intellectuelle au seul usage du marchand, du diffuseur, d’un propriétaire
unique. C’est le principe d’une « intelligence collective » qui est
repris aussi derrière celui de « Licence Art Libre » : l’œuvre
est alors véhiculée et utilisée par une communauté de personnes, de par les
modifications qu’elles apportent à l’œuvre : une communauté
d’auteurs/utilisateurs se forme autour de l’œuvre. À l’instar du réseau des
Arts de la Rue[9],
nous sommes renvoyés à ce qui fait commun dans la gestion d’une ressource
culturelle partagée.[10]
Face à la légitimité basée sur une technologie du savoir
s’oppose ici une autre légitimité basée sur une production en libre situation d’espaces
populaires de création culturelle.[11]
La notion d’ « art participatif » rencontre aussi
sa critique, car il continue à poser une distinction entre artistes et public,
même si ce public est alternativement « acteur » et « regardeur ».
Pas plus que les « ateliers-résidences », les « performances »
et autres interventions n’offrent la panacée. L’art en l’espace public permet
de mettre tout cela en question. En intervenant sur les conditions de réception
et de transmission, il met en débat l’intention artistique, son cadre institutionnel et politique, tout en
construisant sa propre grammaire en situation dans un décalage créatif. Voici
quelques exemples d’espaces :
Les modes d’interventions directes :
Jeax : il y a des personnes qui viennent avec leur disque dur d’ordinateur et font de la projection d’image sur façade.
Popay : un mouvement d’action directe qui colle des affiches peintes 3×4 sur les emplacements d’affiches publicitaires.
Les lieux « alternatifs » :
Alex : Chacun a la possibilité de créer, c’est dans ce sens que j’ai ouvert des squats, organisé des free parties. À la différence des « friches », il y a cette liberté tout en apportant de l’énergie à un projet commun, une expo ou autre. Le point commun, c’est un but créatif. Montrer aux gens que c’est une richesse pour se connaître soi-même et par-là, avoir un rapport avec la société, beaucoup plus libre.
Jeax : j’ai une démarche de squat à la base. À 17 ans, j’ai appris beaucoup de choses dans le fonctionnement, dans la responsabilité des individus, dans la gestion des lieux, et cela, tu ne l’apprends pas dans une maison de quartier, tu ne l’apprends nulle part ailleurs. C’est à la fois très ambigu est c’est beaucoup de richesse dans les rapports humains. Dans les squats on trouve de tout : des artistes confirmés, des amateurs, des personnes « barrées », des personnes construites et c’est cette diversité qui est intéressante. Dans le mouvement squat, dans la démarche artistique, il y a une responsabilité qui pousse à un professionnalisme. On ne fait pas des règles pour faire fonctionner le projet, mais pour faire fonctionner l’humain, dans un respect de l’individu.
Et après, si l’individu se pose bien dans son espace, dans
ce qu’il a à faire, cela fonctionne au niveau du projet. C’est une synergie,
c’est une autre manière de fonctionner en collectif. C’est la différence avec
les institutions, où on te donne un rôle à jouer par rapport à ton poste. Dans
le squat tu as un rôle par rapport à toi-même et par-là, valoriser le
collectif.
Les réseaux
électroniques
Alex : Comment garder des espaces autonomes ? Est-il physique ou mental ? L’espace physique rencontre tout de suite des problèmes : comment tu vas le faire, qui va te donner un espace ? Pourquoi ne pas faire un réseau virtuel ! Il faut utiliser l’outil technologique internet. Chacun reste dans son individualité, mais travaille en groupe virtuel.
L’art numérique
Popay : Travailler en collectif sur une œuvre et obtenir une harmonie, cela reste un défi. Le pouvoir que nous avons sur les outils numériques, il est laissé aux mains de grosses sociétés qui ont besoin de vendre leurs produits. Je trouve dommage qu’il n’y ait pas de réelle proposition : se réapproprier dans l’espace au niveau d’échelle sur les murs, pour ce qu’on sait le faire et même, parce que nous avons un pouvoir d’adaptation, prendre les outils des publicitaires, faire des affiches 3×4 creees numériquement avant. En utilisant le 1 % réservé par le fond architectural pour une œuvre artistique. Il pourrait avoir une station qui serait « le Louvre du graffiti » ou d’autres expressions et qui pourrait être proposée en grand et permettrait à des artistes de trouver une notoriété et une émulation. On peut imaginer aussi un dispositif visuel grand format modifiable numériquement à volonté.
Le mot « alternatif »
est peut-être impropre pour qualifier ces espaces de spontanéité et
de créativité, il permet cependant de qualifier deux types de rapport à
l’espace
- La possibilité de créer là ce qui n’est pas
possible ailleurs, sans moyen financier ou soutien des institutions, sans être
assujetti à des lieux en termes de reconnaissance ou d’organisation, - La possibilité de jouer sur une alternance entre
différents modes d’interventions et d’expériences entre une dimension « interstitielle » (non
formalisée, mais structurante à travers des processus de création et de
transmission) et une dimension intermédiaire (plate-forme de redéfinition
socioprofessionnelle et d’interpellation publique).
Comment faire perdurer ces espaces collectifs en évitant de
tomber dans une gestion de la précarité ? Lorsque ces espaces ne sont pas
fermés, les idées qu’ils génèrent sont récupérées.
Comment faire en sorte que « l’alternative » dans
le temps développe une production, garde trace d’une mémoire collective ?
Pour que ces expérimentations se traduisent en termes de développement, elles
doivent pouvoir renvoyer au questionnement d’intérêt public et d’interpellation
des pouvoirs publics. Ces « zones
autonomes temporaires »[12] constituent
autant d’enjeux de connaissance et de transformation pour ce siècle.
Réf biblio : Hugues Bazin, « Graffiti hip-hop, enjeu d’un art dans l’espace public » in Médias et Contre-cultures, L’Harmattan, 2018, pp. 201-212
[1] Bazin
H., La culture hip-hop, Desclée de Brouwer, 1995.
[2] Riout
D., Qu’est-ce que l’art moderne ? Gallimard., Coll Folio/essai, 2000.
[3] George
É., Du concept d’espace public à celui de relations publiques généralisées,
sciences de la communication, Université du Québec-Montréal, 1999.
[4] Quere
L., « L’espace public comme forme et comme événement », in Prendre
place : Espace public et culture dramatique, Éd Recherches Plan Urbain,
1995, p. 93-110.
[5] Tassin
E., « Espace commun ou espace public ? L’antagonisme de la communauté
et de la publicité », in Hermes (No 10), Espaces publics, traditions et
communautés, CNRS, 1992, p. 23-37.
[6] Scheepers
1., Graffiti And Urban Space, Honours Thesis – University of Sydney
(Australia), 2004.
[7] Lefebvre
H. Espace et politique : Le droit à la ville II, Paris : Anthropos,
(ethno-sociologie ), 2000.
[8] Lamarche-Vade!
G. De ville en ville, l’art au présent, Paris : Éd. de l’Aube, (Société et
territoire), 2001, 172 p.
[9] Manifeste
pour la création artistique dans l’espace public, Fédération nationale des arts
de la rue, 2017.
[10] Maurel
L., « Et si on repensait le Street Art comme un bien commun ? »
blog S.I.Lex, 2018 – Pesta D., « Les communs urbains. L’invention du
commun », Revue Tracés. 2016
[11] Bazin
H, « Espaces populaires de création culturelle : enjeux d’une
recherche-action situationnelle », INJEP, Cahiers de l’action, 2006.
[12] Bey H.
1991, TAZ : Zone Autonome Temporaire, Éd. Autonomedia USA, L’éclat, 1997.
2018_Graffiti-hip-hop-enjeu-dun-art-dans-lespace-public.pdf
Version: 2018