PLATEAU, TERRE D’ACCUEIL
« Siamo tutti stranieri »
nous sommes tous des étrangers
« L’HISTOIRE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, NOUS ENSEIGNE QUE LA FERMETURE D’UNE ROUTE MIGRATOIRE NE RÉDUIT POINT LA MIGRATION, MAIS OUVRE DE NOUVELLES ROUTES QUI COMPORTENT UN BILAN HUMAIN ENCORE PLUS LOURD. LA CRIMINALISATION DES MIGRANTS DANS LES PAYS DE TRANSIT AUGMENTE AU CONTRAIRE LE NOMBRE DE VICTIMES, DE PERSONNES REFOULÉES DANS LE DÉSERT, DANS LES PAYS D’ORIGINE, OBLIGÉES D’EMPRUNTER DES ROUTES DE PLUS EN PLUS IMPRATICABLES. »
(ARCI, ASSOCIATION ITALIENNE QUI TRAVAILLE ENTRE AUTRES SUR LE DROIT DES RÉFUGIÉS.)
« Nous sommes les innombrables, redoublés à chaque case d’échiquier,
Nous pavons de squelettes votre mer pour marcher dessus.
Vous ne pouvez nous compter, une fois comptés nous augmentons, fils de l’horizon, qui nous déverse à seaux.
Nous sommes venus pieds nus, sans semelles, et n’avons senti ni épines, ni pierres, ni queues de scorpions.
Aucune police ne peut nous opprimer plus que nous n’avons déjà été blessés.
Nous serons vos serviteurs, les enfants que vous ne faites pas, nos vies seront vos livres d’aventures.
Nous apportons Homère et Dante, l’aveugle et le pèlerin, l’odeur que vous avez perdue, l’égalité que vous avez soumise. »
(Erri de Luca, Aller simple)

À travers les médias nationaux, les médias indépendants, les récits de camarades voyageurs, nous avons suivi les révolutions arabes, le soulèvement en Syrie, la dictature au Soudan, le massacre des Kurdes en Turquie… Toutes ces guerres et l’exil forcé de millions de personnes qu’elles engendrent.
Depuis notre plateau, impuissants, nous assistions à l’arrivée de tous ces gens bloqués aux portes de l’Europe, à ces milliers de naufragés morts en mer dans l’espoir de rejoindre nos terres et à toutes les horreurs perpétrées par les réseaux de trafics de migrants. Nous regardions se dresser les murs avec leurs hotspots à quelques kilomètres de chez nous pour contrôler les flux migratoires.
Plus de 200 000 personnes sont arrivées par la mer en 2016, dont plus de 5 000 y sont restées, mortes, englouties par les fonds marins. Ne sachant pas nager pour la plupart, sans gilet de sauvetage, entassés comme des bêtes sur des embarcations pourries. Comment pouvoir agir sur cette tragédie, semblable à tant d’autres depuis des siècles ? Se sentir tétanisé de ne pouvoir lier le quotidien avec la réalité des mouvements engendrés par les guerres et les politiques migratoires.
En 2015, l’arrivée d’exilés en France avec le premier démantèlement de la jungle de Calais poussa le gouvernement à créer de nouveaux CADA (centres d’accueil de demandeurs d’asile) ; des CAO (centres d’accueil et d’orientation) et d’autres centres d’hébergements. Pour combler la dite « crise migratoire », le gouvernement lança un appel à des communes de France pour l’ouverture de ces nouvelles structures d’accueil.
De quelle « crise migratoire » parlons-nous ?
Le nombre de migrants désirant rejoindre la France depuis 2010 est ridicule par rapport aux milliers d’Italiens et d’Espagnols venus trouver refuge en France pendant la seconde guerre mondiale, ridicule par rapport aux Européens ayant quitté leur pays pendant la première guerre mondiale, ridicule par rapport à la population mondiale. Les personnes migrantes ne représentent en 2016 que 0,004 % de la population française, pourcentage invisible à l’œil nu sur un diagramme.

C’est quoi, vos origines ?
« Est-ce que vous avez des origines ? » demande un enfant de 8 ans d’une école primaire d’un quartier dit « difficile » de Nantes, lors d’une rencontre avec un groupe de musique. « On dirait que vous êtes Italiens. » Il lui avait été demandé de poser des questions sur le groupe, la musique, mais il lui semblait bien plus important de savoir l’origine des inconnus qu’il avait en face de lui. Tous les jours, la société lui rappelle, à cet enfant, qu’il a des origines, qu’il vient d’ailleurs.
Tout le monde a des origines, des traces des peuples déplacés, des mélanges de populations.
Les migrations sont aussi anciennes que l’humanité.
Les flux migratoires, le déplacement de populations, la circulation de pays en pays fait partie de l’histoire de notre planète, de la richesse de ses peuples et de ses cultures.
Les migrations écologiques, économiques, politiques, professionnelles, affectives, de survie dues à des persécutions, des guerres, des famines…
Des flux incessants depuis la nuit des temps
Les rapports étroits entre la France et le Maroc depuis le début du XIXe siècle transforme la langue française orale. Des mots et des expressions souvent déformés font partie du vocabulaire argotique et viennent de la langue arabe : toubib (médecin), kawa (café), klebs (chiens)…
Mélange des langues
Mélange des musiques, des chants, des goûts et des coutumes.
Les guerriers « huns» à la chute de l’Empire romain amenèrent la recette des choux fermentés en Europe. Ils sont devenus les fameux choux utilisés pour la choucroute labellisée « alsacienne » !
Les frontières
Dans les années 1990, les frontières de l’Europe s’ouvrent, deviennent des no man’s land, des bâtiments vides, des aires de covoiturage, des parkings. L’espace Schengen fonctionne comme un espace unique en matière de voyages internationaux et de contrôles frontaliers, sans contrôle des frontières internes.
Nous, Européens, pouvons circuler, partir pour un temps, revenir, aller dans de nombreux pays du monde.
Cependant, depuis les années 2000, l’Europe se braque, les frontières de l’espace Schengen reprennent leurs fonctions, deviennent infranchissables, encerclant l’Europe. L’Europe avec ses murs, ses barbelés, ses chiens et ses gardes-frontières, ses milices privées.
Les pays européens s’allient pour mieux contrôler les flux, ficher les populations, rapatrier les indésirables.
 En 2004, l’Europe s’arme : elle crée Frontex, l’agence européenne pour la Gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Frontex a des moyens militaires colossaux pour lutter contre l’arrivée des migrants en Europe (des armes, des bateaux, des hélicoptères, des lunettes infrarouge, des détecteurs de battement de cœur….).
En 2004, l’Europe s’arme : elle crée Frontex, l’agence européenne pour la Gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Frontex a des moyens militaires colossaux pour lutter contre l’arrivée des migrants en Europe (des armes, des bateaux, des hélicoptères, des lunettes infrarouge, des détecteurs de battement de cœur….).
Frontex contrôle les murs aux frontières, surveille les mers, organise les charters de rapatriement, trie les migrants à l’arrivée des bateaux, prend de force les empreintes digitales, avec gégène si besoin, s’occupe du démantèlement de Calais. Frontex laisse des milliers de réfugiés se noyer en mer, faisant le choix de ne pas les secourir. Frontex reçoit de l’Europe plus de 120 millions d’euros en 2016.
Des personnes fichées anarcho-autonomes se voient refuser leur visa pour les États-Unis au moment de l’investiture de Trump. Aucune raison ne leur sera donnée.
Est-ce juste pour le temps de la cérémonie ou pour toute la durée de la candidature de Trump ?
Trump refuse l’accès aux États-Unis à six pays musulmans. Nouveau décret pour maintenir hors des frontières les « terroristes islamistes radicaux ».
Si la circulation était libre comme l’indique la Convention universelle des Droits de l’homme, les déplacements seraient fluides, les gens iraient, viendraient.
« ARTICLE 13
1. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET DE CHOISIR SA RÉSIDENCE À L’INTÉRIEUR D’UN ÉTAT.
2. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE QUITTER TOUT PAYS, Y COMPRIS LE SIEN, ET DE REVENIR DANS SON PAYS. »
Il n’y a pas plus de crise migratoire que d’invasion. Mais bien un besoin de contrôler, de réprimer, de dominer.

Un centre d’accueil à Peyrelevade, un jeu d’échecs dans un univers carcéral
Deux CADA ouvrirent leurs portes, un à Eymoutiers en 2014 et un à Peyrelevade en 2015. À Peyrelevade, 80 personnes vivent en permanence tassées dans l’ancienne maison de retraite du village. L’odeur, les tapisseries, le lino, tout dans ce lieu rappelle son ancienne affectation et donne un goût âpre aux perspectives de ses nouveaux résidents. Dans des chambres à peine grandes comme des cellules, les demandeurs d’asile se succèdent. Après un an, deux ans ou trois ans de calvaire administratif, 70% des demandeurs d’asile voient leurs demandes refusées et sont forcés de quitter le dispositif CADA. Ils se retrouvent à la rue, sans rien, ni revenu ni droit au travail. Dès leur chambre libérée, celle-ci sera remplie par de nouveaux arrivants. Venus des quatre coins du monde, Guinée, Nigeria, Bosnie, Algérie, Afghanistan, Kosovo, Russie, Djibouti, Congo, Éthiopie, Soudan, Érythrée… des hommes seuls, des femmes seules, des enfants, des familles, défilent dans ces centres en attendant leur destin.
Suivre les directives européennes d’accueil des migrants, les quotas d’acceptation, telle est la devise des travailleurs sociaux en gérance de la plupart des structures d’accueil de migrants.
Ils jugent les résidents dès leur arrivée, ils jugent leur entourage, leur fréquentation, et surtout leur récit, leur histoire, seule chose qui leur appartient encore.
Notre mémoire se troue là où elle ne veut se souvenir.
Notre mémoire se forme, se transforme, devient notre réalité.
Notre réalité est faite de souvenirs, de cassures, de traumatismes…
Notre réalité est notre histoire.
Notre histoire est en mouvement, elle ne peut se figer.
Notre histoire n’est pas la même que celle de notre frère ou que celle de notre mère.
Le trauma fait oublier.
Une femme, enceinte suite à un viol, raconte à un médecin lors de son arrivée en Europe, après des mois de voyage, n’avoir jamais eu de rapport sexuel, être persuadée d’être vierge.
Notre mémoire laisse place à la survie.
Elle se troue, elle se bouche, elle se floute.
Il reste du flou, ou juste des odeurs, des couleurs, des mots, des lieux ou des visages dont on ne sait le nom.
Ces questions, cette mémoire, le récit de leur vie, pour les demandeurs d’asile, se fige le temps de la procédure.
Leur vie devient un récit froid, qui ne peut changer, comme si leur passé appartenait aux autorités.
Et les flash-back, et les oublis ?
Non, plus rien n’est possible.
Un récit écrit est un récit fini.
Ce récit est leur seule défense.
Défense face à la prose de l’OFPRA (office fédéral de Protection des réfugiés apatrides).
Une prose qui ressemble étrangement à la prose policière.
Prose bien loin de la réalité, fantasmant des relations inexistantes, réécrivant la vie des gens à leur sauce, en y mettant déjà un a priori, ou des fascinations qui sont celles de policiers ou d’autres fonctionnaires de l’État.
Une prose qui cherche le mensonge. Qui doute, qui enquête pour chercher la faille dans la vie des gens jusqu’à en faire douter les interrogés sur leur propre nom, ou sur la date de naissance de leur mère.
« Il y a une erreur dans votre nom. »
Je n’ai pas de papiers, on me les a volés pendant la traversée. Je ne peux prouver mon identité.
« Vous êtes enregistré mais sous un autre nom. »
Je ne porte pas seulement le nom de mes parents comme chez vous.
Mon nom comprend toute une histoire, celle d’un arbre généalogique.
J’ai le nom de tous ceux qui me composent, de mes ancêtres.
Je ne peux pas avoir qu’un seul nom mais trois ou quatre.
Avoir un seul nom serait arracher une partie de moi-même, de mes ancêtres.
« Écorché, tu te nommeras écorché. »
Tu te nommeras avec deux S et un H ou tu ne te nommeras pas car tu ne peux le prouver.
Et en plus vous n’avez pas d’empreintes.
« Vous êtes non identifiable. »
Être sans histoire, être sans papiers, sans nom, sans date de naissance.
Que reste-t-il ?
L’achat de récits tout faits, vendus par les trafiquants de vie, les voleurs d’humanité, les brûleurs d’empreintes. Avoir l’asile est un parcours du combattant. Dans le combat tout est possible, vendre son histoire, vendre son nom, perdre son identité.
Mon histoire, est-elle assez vraie, est-elle assez triste, est-elle assez horrible ?
Ai-je bien raconté, ai-je bien insisté sur les points cruciaux ?
Toute cette pression persiste tout le long de leur démarche.
Toute rencontre dans ce contexte est donc compliquée.
Comment peuvent-ils transmettre leur histoire, l’histoire de leur pays, en s’échappant de cette spirale infernale qui est leur « récit », le « récit » de leur vie, celui qu’ils ont raconté à l’administration française.
Apprendre à raconter.
Apprendre à se rencontrer.
Nous et le Plateau
Nous avions été accueillis les bras ouverts par Jean Plazanet il y a dix ans, nous avons été bercés depuis notre arrivée par l’histoire de la résistance et par la fameuse expression : « Plateau, terre d’accueil ». Pourtant l’accueil des réfugiés depuis l’ouverture des CADA, ne fut pas une évidence. Peur de l’inconnu, peur du vol du travail, peur de l’invasion. Nos régions ne proposent plus de travail depuis bien longtemps. L’économie vivote, les maisons se vident et les classes se ferment par manque d’effectifs. L’arrivée des « néo » il y a une dizaine d’années a redonné vie à cette région désertée mais sa population reste encore très faible.

La peur est le mot d’ordre des sociétés capitalistes. Neutraliser les citoyens par la peur. Mettre en état de choc, à travers les médias, des populations entières, par des faits divers (viols collectifs, agressions, vols..) soi-disant commis par des migrants. Mettre en état de choc afin de faire passer des lois sécuritaires qui vont au-delà du contrôle des migrants. Certains Parisiens à la retraite, certains dits « de souche » et habitant la Montagne limousine depuis plusieurs générations, des socialistes, des jeunes, des vieux… Beaucoup, matraqués par les médias, tremblent dans leurs chaumières.
Mais qu’est-ce que vous leur proposez, quel avenir pour eux, qu’est ce qu’ils vont faire ici sur le Plateau?
Se reposer, prendre un temps pour attendre, rencontrer des gens sur qui compter, à qui parler, des amis, l’amour, ou rien peut- être, ou seulement un peu de chaleur dans le froid du Plateau.
C’est à croire qu’ils en oublient leur passé, qu’ils en oublient l’histoire, l’histoire de notre monde. D’où venons-nous ? Ne sommes-nous pas tous de partout et d’ailleurs, d’ici et de nulle part ? SIAMO TUTTI STRANIERI
Pourquoi avoir si peur que nos villages désertés reprennent vie?

À notre arrivée, nous avions rencontré de vieux Espagnols. Ils nous ont conté leur vie, pas celle d’ici, celle de l’Espagne. Comme si leur vie avait pris fin une fois la frontière passée. On sentait entre nous une proximité, celle de se sentir étranger à ce monde, celle de vouloir se battre et dont la lutte est la vie.
Les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Kurdes, les esclaves des fermes, les enfants réunionnais, les néo et maintenant les milliers de personnes fuyant les guerres provoquées par les grandes puissances occidentales.
Nous traversons des territoires, nous apprenons à les aimer, à connaître leur rudesse et leur beauté, à rencontrer leurs habitants. Nous nous retrouvons ensemble, ici, pour tenter quelque chose, pour reprendre nos vies en main, parce que nous pensons qu’ensemble c’est plus facile que tout seul. Pour se battre contre les inégalités, pour être libres d’agir sur l’éducation de nos enfants, sur notre corps, sur notre santé, pour savoir ce qu’on mange, savoir produire, se réapproprier les moyens de subsistance, les moyens de construire nos maisons, et trouver la force de lutter contre ceux qui nous oppriment et qui veulent faire de ce monde un cimetière géant.
«Les gouvernements ont choisi le camp de la mort, nous sommes du côté de la vie. Migrants, bienvenue! » manifestation contre l’expulsion de la jungle de Calais en décembre 2016 à Tulle.
Ne pas perdre notre histoire, rencontrer celle des autres, lutter au jour le jour.
« Terre d’accueil » ne fait pas consensus sur notre territoire.
Un tag fraîchement peint qui disait « Accueil des migrants » a été modifié en « A. C des migrants » (assez des migrants) puis en « virons les migrants » puis en « un migrant = 1 balle ». Ces slogans nous font froid dans le dos et nous rappellent une époque pas très lointaine.
Froid dans le dos, comme ce slogan scandé dans une manifestation de policiers en grève à Paris : « toute la racaille en prison ! ».
La montée du fascisme dans nos campagnes profondes s’accélère. Le fascisme, seule chose à laquelle les perdus de notre terre peuvent se rattacher dans ce chaos général.
Nous voulions creuser dans le passé de notre territoire, comprendre comment on en était arrivé là et comment avaient été réellement accueillis ces Italiens, Espagnols, Portugais, Kurdes, turcs, Réunionnais, néos… qui peuplent les terres du Limousin depuis des décennies.
Nous voulions en savoir plus…
Un peu d’histoire des migrations en Limousin
Les italiens tailleurs de pierres
 « Fano Delprato a fui le fascisme pour venir faire un travail de bagnard dans le Limousin. Il n’est jamais retourné en Italie. Un jour, son fils Joël a réussi à décider son père de faire le voyage ensemble : les voilà partis en voiture. À l’approche de la frontière, il sent son père se crisper ; puis ça y est, ils sont en Italie. Moins de cinquante kilomètres après, Fano dit à son fils : « S’il te plaît, fais demi-tour… « Joël a bien senti que ce n’était pas la peine d’insister, impossible de retourner là-bas. Ils sont revenus à Pontarion ; ils n’ont plus jamais reparlé de l’Italie. »
« Fano Delprato a fui le fascisme pour venir faire un travail de bagnard dans le Limousin. Il n’est jamais retourné en Italie. Un jour, son fils Joël a réussi à décider son père de faire le voyage ensemble : les voilà partis en voiture. À l’approche de la frontière, il sent son père se crisper ; puis ça y est, ils sont en Italie. Moins de cinquante kilomètres après, Fano dit à son fils : « S’il te plaît, fais demi-tour… « Joël a bien senti que ce n’était pas la peine d’insister, impossible de retourner là-bas. Ils sont revenus à Pontarion ; ils n’ont plus jamais reparlé de l’Italie. »
Dans les années 1920, le plateau de Millevaches accueille des Italiens par milliers fuyant pour la plupart le fascisme. Ceux-ci travaillent dans la taille de pierre, dans des conditions extrêmes. Ils ont bâti des maisons, des églises, des ponts et des trottoirs. Beaucoup de trottoirs. Ils ont taillé, beaucoup.
Taillé dans les blocs de granit immenses qu’ils pétaient à la dynamite.
Ces trottoirs qui nous paraissent si anodins, où les chiens déversent leurs excréments, sur lesquels on marche à longueur de journée…
Les « Macaronis » , voilà le surnom que ceux qui ne voulaient pas d’eux utilisaient pour les nommer !
Là où ils ont travaillé toute leur vie, là où ils ont grandi, là où ils sont morts, là où ils ont fait des enfants, là où ils habitent, ils sont toujours restés considérés comme des étrangers.
Les maquisards espagnols
 À partir de 1936, des milliers d’Espagnols fuient le franquisme et atterrissent en France. Des camps de travail voient le jour un peu partout. Parqués comme des bêtes et surveillés par le régime de Vichy. Tout particulièrement ceux fichés « anarchistes » ou « communistes ».
À partir de 1936, des milliers d’Espagnols fuient le franquisme et atterrissent en France. Des camps de travail voient le jour un peu partout. Parqués comme des bêtes et surveillés par le régime de Vichy. Tout particulièrement ceux fichés « anarchistes » ou « communistes ».
Beaucoup d’Espagnols seront déportés et livrés aux Allemands par le régime de Vichy. Ils mourront, pour la plupart, dans les camps d’extermination allemands. D’autres seront renvoyés de force dans l’Espagne fasciste qu’ils avaient fui. Pour les Espagnols ayant réussit à fuir la déportation, nous retrouverons leur trace dans les maquis du Limousin, aux côtés des maquisards français participant à la Libération. Retrouvant enfin leur place et leurs marques, enseignant l’art de la guérilla aux maquisards français.
Nous étions en temps de guerre.
En état de guerre, nous le sommes encore, les containers de calais encerclés par des barbelés et surveillés par des gardes-mobiles, toutes les expulsions massives, l’entassement dans des camps aux frontières, les centres fermés, les viols, violences et assassinats perpétrés par la police.
Le 18 mars 2016, la Turquie et l’Union européenne ont convenu d’un plan global pour réduire la migration vers l’Europe. Le but de cet accord est de réduire le franchissement irrégulier des frontières, de renvoyer les migrants en situation irrégulière de force dans leur pays d’origine, de créer des camps dans les pays en guerre (Syrie…) et d’aider les dictateurs des pays d’où proviennent les réfugiés à contrôler leurs opposants.
« Coopérer pour mieux expulser »
Les migrants provenant de pays dictatoriaux ayant des accords avec l’Europe voient leur demande d’asile refusée, car ils sont considérés comme des migrants économiques et non politiques. Conséquence directe de cette stratégie européenne, des dictatures telles que l’Érythrée, le Soudan ou la Gambie utilisent le rôle de partenaire que l’Union européenne leur a attribué dans la lutte contre l’immigration, pour se réhabiliter face à l’opinion publique internationale, en tentant de faire passer au second plan les crimes qu’elles ont commis.

« CONCRÈTEMENT, L’UE VISE, EN PARTICULIER LE GOUVERNEMENT ITALIEN, À ESSAYER DE TRANSFÉRER NOS FRONTIÈRES EN AFRIQUE, OU MÊME DIRECTEMENT DANS LES PAYS D’ORIGINE, EN BLOQUANT DÈS LE DÉPART LES MIGRANTS « ÉCONOMIQUES » ET LES DEMANDEURS D’ASILE, C’EST-À-DIRE LES PERSONNES QUI FUIENT LA GUERRE ET LES PERSÉCUTIONS. DANS CE CAS, LES RELATIONS AVEC DES DICTATURES SONT ÉGALEMENT NORMALISÉES. L’UE EST MÊME PRÊTE À DIALOGUER AVEC LE DICTATEUR ÉRYTHRÉEN ISAIAS AFEWERKI, AU POUVOIR DEPUIS 1993 DANS UN PAYS D’OÙ PROVIENT UN DES GROUPES DE PERSONNES LE PLUS NOMBREUX À LA RECHERCHE DE PROTECTION, À CAUSE JUSTEMENT DU MANQUE TOTAL DU MOINDRE SEMBLANT DE DÉMOCRATIE ET DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ; TOUT CELA MALGRÉ LES LOURDES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE ONUSIENNE SUR LES CRIMES COMMIS EN ÉRYTHRÉE. » (ARCI)
C’est également l’esprit du processus de Khartoum, signé le 28 novembre 2014 entre l’Union européenne et une vingtaine de pays africains, du Soudan à la Libye. L’Europe finance des formations de surveillance, renforce les contrôles aux frontières, établit des camps, vise à interrompre les flux de transit. Les services de renseignements des pays africains dictatoriaux travaillent de pair avec les polices européennes pour repérer, dans les camps, les gens fichés, les opposants.
Beaucoup étaient à Calais, sans procédure de demande d’asile, ils ne sont pas enregistrés en France, ils sont renvoyés de force sans laisser de trace.
Un fonctionnement qui nous rappelle des moments douloureux de l’histoire des dictatures d’Amérique latine, « l’opération condor ».
Dans les années 1970, les services secrets du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay et avec le soutien des États-Unis, travaillent ensemble pour poursuivre et assassiner des dissidents politiques. Ces services iront jusqu’en Europe et aux États-Unis.
Les pupilles de La Réunion : les enfants de la Creuse, une migration forcée
Danyel Waro – Banm Kalou Banm – YouTube
« Chicaud, ala in nafèr pou ou. Astèr fèrm out bous, tak ali pou touzour. »

En 1965, les élèves d’une école rurale de Lozère.
« J’ai souvenir d’un temps où le soleil irradiait nos moindres mouvements, où les éclats de rires accrochaient les étoiles dans nos regards d’enfants où l’innocence était encore un trésor dans nos cœurs ardents. J’ai souvenir d’un temps qui fut comme un rêve et comme un avant. » (Un enfant devenu pupille de l’État)
« Historien de l’enfance orpheline, j’ai rarement été confronté à tant de souffrances. Dans les archives, on trouve des cas d’enfants de 12 ans qui font des tentatives de suicide, qui sont internés, tombent en dépression. On trouve des lettres désespérées qui supplient l’administration de rapatrier leurs auteurs à la Réunion.»
« Ce qui se passe en outre-mer dans les années 1960-1980 rend visible une nouvelle configuration de la société française que l’on peut appeler « post-coloniale ». La Ve République réorganise, dans le contexte de la guerre d’Algérie, son espace post-colonial et, quelques années après l’indépendance de l’Algérie, introduit de nouveaux réaménagements dans les domaines économiques, politiques, sociaux et culturels dans les outre-mer…une nouvelle carte du territoire apparaît, distinguant ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. » (Françoise Vergès, Le ventre des femmes)
À l’origine de cette affaire d’enfants déportés, il y a Michel Debré, alors député gaulliste de La Réunion et ministre de la Guerre. Confronté à la crise de l’île, marquée par la grande pauvreté et le chômage, Michel Debré préconise la ponction d’une partie de la jeunesse réunionnaise qu’il fait venir en métropole, surtout dans les zones rurales (Creuse, Lozère, Gers, Lot, etc.).
Michel Debré et son gouvernement gaulliste luttent contre le communisme et continuent sur les traces de la guerre d’Algérie, de mettre en place la contre-insurrection.
Ayant peur que cette jeunesse pauvre et livrée à elle-même ne se soulève, ils veulent contrer l’emprise du communisme sur cette population démunie.
«C’est dans la misère que naît le communisme. » (Michel Debré)
Entre 1963 et 1981, 1 615 enfants ont été transférés de la DDASS de La Réunion au foyer de Guéret en Creuse puis dispatchés dans toute la France.
Michel Debré donne des directives et engage une campagne de publicité pour persuader les familles.
« L’Eldorado c’est la France. »
Pour être transférés, les enfants, sélectionnés dans les orphelinats ou les quartiers les plus pauvres de l’île, doivent être immatriculés comme «pupille d’État», c’est-à-dire que leurs parents –lorsqu’ils existent– doivent renoncer à tout droit sur eux. Ces enfants appartiennent à l’État français qui pourra faire d’eux ce qu’il veut.
Des centaines de parents illettrés signent des procès-verbaux d’abandon qu’ils ne peuvent pas déchiffrer.
On promettait aux parents un avenir de médecin et d’avocat pour leurs enfants, et surtout un retour de ceux-ci pour les vacances.
Ils furent escroqués car jamais ils ne revirent leurs enfants.
Pour les choisir, des assistantes sociales enquêtent dans les bidonsvilles de La Réunion puis émettent des rapports ignobles.
« Ils vivent comme des bêtes. »
« Ce sont des sauvages. »,
« Les enfants sont en danger, les parents sont des ivrognes. »
La plupart des familles seront forcées.
Ces bébés, ces enfants, ces adolescents seront endormis pendant le trajet en avion.
Ils ne se rappellent que de l’atterrissage en France.
À leur arrivée à Guéret, ils seront triés par âge et désinfectés.
L’esclavagisme sera le destin de ces enfants.
Les plus âgés seront envoyés dans des fermes, travaillant comme des esclaves, maltraités, mal nourris et pour certains violés.
D’autres resteront dans des centres fermés, eux aussi violés, maltraités, et faisant l’objet d’un lavage de cerveau quotidien sur les bienfaits de la France.
Des fillettes seront envoyées au couvent, ou placées comme bonnes dans des familles.
Certains ont eu un peu plus de chance et ont été placés en familles d’accueil ou adoptés.
Ils perdirent jusqu’à leurs vrais noms et furent rebaptisés par leurs camarades de classe, leur patron ou leur surveillant « Chocolat », « Mousse », « Petit noiraud ».
Aucun impact démographique n’aura eu lieu ni à la Réunion ni dans les régions de France où ils furent déportés.
Cette histoire reste secrète, l’État n’a jamais voulu reconnaître l’atrocité de ses gestes.
Les Kurdes en Corrèze
« Peyrelavade, la difficile intégration de 56 Kurdes »
« Ces réfugiés font un effort pour s’intégrer, les jeunes filles ne portent plus le foulard traditionnel, la vie dans les gîtes passe par l’observation de règles explicitées par les autorités locales. » (extrait d’un quotidien de l’époque)
Le Kurdistan s’étend sur trois pays : le sud de la Turquie, le nord de la Syrie et l’Irak. Dans les années 1980, des Kurdes, réfugiés politiques, fuient les régimes turc et irakien. Les Kurdes naissent apatrides, le régime turc ne leur donne pas de papiers, pas d’état civil.
Naître apatride dans son propre pays.
N’avoir aucun droit, même pas celui de vivre, de parler de politique sans être surveillé, torturé, massacré, persécuté.
De nombreux Kurdes ne pouvant supporter de rester en Turquie en subissant le régime, en restant la tête baissée, ont décidé de prendre les armes.
Après des années de lutte face à la répression grandissante, certains sont forcés de fuir dans d’autres pays et d’y poursuivre leur combat, de lutter pour leur peuple au-delà des frontières.
En 1989, plus de 300 Kurdes, fuyant les exactions dont ils sont victimes en Irak, arrivent en Auvergne. Après deux mois passés au camp militaire de Bourg-Lastic, dans le Puy-de-Dôme, une soixantaine d’entre eux « débarquent » à Peyrelevade, au cœur de la Montagne limousine, pendant que d’autres sont accueillis en Creuse, à Mainsat, ou encore dans le Puy-de-Dôme ou en Ariège. La plupart partiront vers les villes une fois leur demande d’asile acceptée.
Et bien d’autres histoires
La France a accueilli sans problème 128 531 Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens dans les années 1980. Et maintenant elle s’effraie d’accueillir à peine 30 000 réfugiés.
Bien d’autres histoires se sont passées sur notre territoire mais nous ne pouvons toutes les conter.
Il faut savoir se rappeler. Savoir laisser des traces.
Savoir transmettre tel un ménestrel les musiques qui nous ont bercés, les gens qui nous ont précédés, les choses qui se sont passées, les choses qui sont restées cachées.
Apprendre du passé nourrit notre présent.
Le perpétuel recommencement laisse sans voix.
«Vogliono rimandarci, chiedono dove stavo prima, quale posto lasciato alle spalle.
Ils veulent nous renvoyer, ils demandent où j’étais avant,
quel lieu laissé derrière moi.
Mi giro di schiena, questo è tutto l’ indietro che mi resta, si offendono, per loro on è la seconda faccia
Je tourne le dos, c’est tout l’arrière qu’il me reste.
Ils se vexent, pour eux ce n’est pas une deuxième face.
Noi onoriamo la nuca, da dove si precipita il futuro che non sta davanti, ma arriva da dietro e scavalca.
Nous, nous honorons la nuque, d’où s’élance l’avenir
qui n’est pas devant, mais qui arrive par-derrière et enjambe.
Devi tornare a casa. Ne avessi une, estavo.
Nemmemo gli assassini ci rivogliono.
Tu dois rentrer à la maison. Si j’en avais une, je serais resté.
Même les assassins ne veulent plus de nous.
Rimetteteci sopra la barca, scacciateci da uomini,
non siamo bagagli da spedire e tu nord non sei degno di te stesso.
Remettez-nous dans le bateau, chassez-nous en hommes,
nous ne sommes pas des bagages à expédier et toi, Nord, tu n’es pas digne de toi-même.
La nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi, nostra patria una barca, un guscio aperto.
Notre terre engloutie n’existe pas sous nos pieds,
notre patrie est un bateau, une coquille ouverte.
Potete respingere, non riportare indietro,
è cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata.
Vous pouvez nous repousser, non pas ramener,
le départ n’est que cendre dispersée, nous sommes des aller simples »
Erri de Luca, « Aller simple »











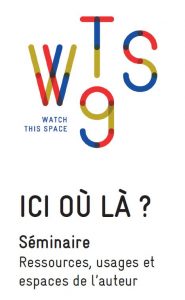

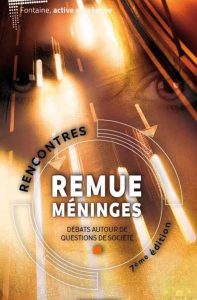


 En 2004, l’Europe s’arme : elle crée Frontex, l’agence européenne pour la Gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Frontex a des moyens militaires colossaux pour lutter contre l’arrivée des migrants en Europe (des armes, des bateaux, des hélicoptères, des lunettes infrarouge, des détecteurs de battement de cœur….).
En 2004, l’Europe s’arme : elle crée Frontex, l’agence européenne pour la Gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Frontex a des moyens militaires colossaux pour lutter contre l’arrivée des migrants en Europe (des armes, des bateaux, des hélicoptères, des lunettes infrarouge, des détecteurs de battement de cœur….).


 « Fano Delprato a fui le fascisme pour venir faire un travail de bagnard dans le Limousin. Il n’est jamais retourné en Italie. Un jour, son fils Joël a réussi à décider son père de faire le voyage ensemble : les voilà partis en voiture. À l’approche de la frontière, il sent son père se crisper ; puis ça y est, ils sont en Italie. Moins de cinquante kilomètres après, Fano dit à son fils : « S’il te plaît, fais demi-tour… « Joël a bien senti que ce n’était pas la peine d’insister, impossible de retourner là-bas. Ils sont revenus à Pontarion ; ils n’ont plus jamais reparlé de l’Italie. »
« Fano Delprato a fui le fascisme pour venir faire un travail de bagnard dans le Limousin. Il n’est jamais retourné en Italie. Un jour, son fils Joël a réussi à décider son père de faire le voyage ensemble : les voilà partis en voiture. À l’approche de la frontière, il sent son père se crisper ; puis ça y est, ils sont en Italie. Moins de cinquante kilomètres après, Fano dit à son fils : « S’il te plaît, fais demi-tour… « Joël a bien senti que ce n’était pas la peine d’insister, impossible de retourner là-bas. Ils sont revenus à Pontarion ; ils n’ont plus jamais reparlé de l’Italie. » À partir de 1936, des milliers d’Espagnols fuient le franquisme et atterrissent en France. Des camps de travail voient le jour un peu partout. Parqués comme des bêtes et surveillés par le régime de Vichy. Tout particulièrement ceux fichés « anarchistes » ou « communistes ».
À partir de 1936, des milliers d’Espagnols fuient le franquisme et atterrissent en France. Des camps de travail voient le jour un peu partout. Parqués comme des bêtes et surveillés par le régime de Vichy. Tout particulièrement ceux fichés « anarchistes » ou « communistes ».


 Marcelo Negrao (Ancien salarié de France Libertés, doctorant sur les catadores)
Marcelo Negrao (Ancien salarié de France Libertés, doctorant sur les catadores)










